lingvo.wikisort.org - Langue
Le provençal (endonyme : provençau selon la norme classique ; prouvençau selon la norme mistralienne) est un dialecte occitan[2],[3],[4] (selon le Ministère français de la Culture[5]) parlé en Provence[6],[7], dans l'Est du Languedoc[8] et dans les vallées occitanes du Piémont[alpha 3].
Pour les articles homonymes, voir Provençal (homonymie).
Pour la notion de « langue provençale » qui désignait l'intégralité de la langue d'oc jusqu'à son renommage vers 1930, voir occitan.
| Provençal Provençau / Prouvençau | |
| Pays | France, Italie[alpha 1] |
|---|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes (« Drôme provençale » et Trièves), Occitanie (« Gard provençal »), Province de Turin, Province de Coni, Guardia Piemontese (Province de Cosenza en Calabre) |
| Nombre de locuteurs | De 100 000[1] à 500 000 |
| Classification par famille | |
|
|
| Codes de langue | |
| IETF | oc-provenc
|
| ISO 639-1 | oc
|
| ISO 639-3 | oci [alpha 2]
|
| Linguasphere | 51-AAA-gc
|
| Glottolog | prov1235
|
| Échantillon | |
Article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme (voir le texte en français)
|
|
| modifier |
|
Le dialecte « provençal » ne doit pas être confondu avec la « langue provençale », expression qui désignait l'intégralité de la langue d'oc avant sa substitution progressive par le terme « occitanien », puis « occitan » à partir des années 1930[9],[10]. Mais de Frédéric Mistral à Max-Philippe Delavouët, le provençal est bien la langue de la Provence, riche elle-même de variétés dialectales.
Les parlers inclus dans le domaine dialectal provençal varient selon les chercheurs : si la majorité y range le rhodanien, le maritime et le niçois, l'inclusion du vivaro-alpin est sujette à caution ; le languedocien et le provençal sont parfois associés dans un ensemble nommé « occitan méridional » (ou « provençal moyen ») excluant le vivaro-alpin qui se trouve compris dans l'ensemble « nord-occitan ».
Le provençal littéraire fleurit dès le XIe siècle dans les compositions des troubadours et trobairitz qui écrivent souvent dans une forme générale de langue d'oc pouvant néanmoins déjà présenter un certain nombre de traits dialectaux provençaux, que l'auteur soit ou non provençal. À partir du xiiie siècle le provençal se substitue au latin[11] en devenant la langue de la justice, des actes, des délibérations administratives et des chroniques. D'abord maintenu dans son rôle de langue juridique par le pouvoir royal suite à l'association du Comté de Provence avec le Royaume de France, son usage dans les actes officiels décline lentement à partir du XVIe siècle jusqu'à la Révolution et l'établissement de la Convention nationale[12]. Dès lors, exclu de l'administration, il demeure néanmoins la langue courante à l'oral de la grande majorité de la population et se maintient sur le plan littéraire.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle le provençal bénéficie d'un travail de normalisation entamé par Simon-Jude Honnorat qui s'inscrit dans la droite lignée des « trouvères marseillais ». Frédéric Mistral d'abord enclin à suivre cette graphie se ralliera à celle plus phonétique de Joseph Roumanille, ce qui initiera la Respelido (« renaissance »)[13],[D 1]. À cette norme dite « mistralienne » s'oppose, à partir de la première moitié du XXe siècle, à la « norme classique », une nouvelle proposition orthographique pensée par le languedocien Louis Alibert, inspirée par les travaux d'Antonin Perbosc et de Prosper Estieu, du catalan Pompeu Fabra et de ses prédécesseurs provençaux[14], qui se veut transdialectale et plus proche de la langue des troubadours.
Les provençaux parlaient encore leur langue au XVIIIe siècle comme en témoigne un appel au calme rédigé en provençal envoyé par le roi Louis XVI[alpha 4]; ce n'est qu'au début du XXe siècle que les parents cessèrent par honte ou par espoir d'ascension sociale d'élever leurs enfants en provençal[11],[15],[alpha 5]
Grâce à Frédéric Mistral le provençal reçut l'un des premiers Prix Nobel de Littérature.
Le provençal est classé par l'Atlas interactif UNESCO des langues en danger dans le monde comme langue en situation sévère d'extinction[16].
Définition
Le statut du provençal, dialecte de l'occitan ou langue à part entière, est une question qui divise le monde universitaire en deux clans, chacun se revendiquant d'arguments scientifiques pour tenter de faire valoir son point de vue[17].
Dans leur livre « Grammaire provençale » publié en 2007, Guy Martin et Bernard Moulin proposent deux définitions pour le provençal, l'une retenue par le monde universitaire qu'on pourra qualifier de « scientifique » et l'autre animée par des sentiments sociolinguistiques (liens historiques, culturels, politiques), qu'on qualifiera de « populaire », à savoir :
- Scientifique : L'occitan oriental, celui de Provence, est décomposé en deux zones, l'une sud-occitane et l'autre nord-occitane respectivement séparées par les isoglosses « Ca / Ga » (au sud) et « Cha / Ja » (au nord). Cette représentation reprend les délimitations de Frédéric Mistral. Les auteurs du livre nomment « rhodano-méditerranéen » le dialecte provençal comprenant les sous-dialectes maritime, bas-rhodanien, la zone d'interférence (rhodanien / maritime, maritime / alpin) et le niçois. Le « rhodano-alpin » (ou « vivaro-alpin ») est constitué par les sous-dialectes « intra-alpin », « nord-rhodanien », « inalpin » (ou « transalpin »). Les auteurs précisent que le dialecte rhodano-méditerranéen est en extension au-dessus de Digne-les-Bains, quant aux sous-dialectes maritime et niçois, ils ont tendance à s'auto-influencer (adoption par certains niçois de la diphtongue [wa] « oua » au lieu de [wɔ] « ouo » ; utilisation du niçois ou influence du niçois sur la rive gauche du Var[18]).
- Populaire : L'ensemble des sous-dialectes de la basse Provence qui forment le dialecte provençal par Mistral avec les sous-dialectes du Dauphiné formant le dialecte dauphinois par le même auteur, dont le territoire faisait partie, à ses débuts, du Comté de Provence.
Classification
La classification dialectologique du provençal au sein de l'espace occitan diffère selon les auteurs entre les partisans d'une vision « nord-sud » (occitan oriental) et « est-ouest » (occitan méridional ou occitan moyen).
Selon Frédéric Mistral[A 1], les sous-dialectes du provençal sont : le « rhodanien », parlé dans la partie occidentale des départements des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse, jusque dans la région de Nîmes (partie orientale du Gard) ; le « marseillais » (devenu « maritime » dans la terminologie contemporaine) entre les villes de Marseille, d'Aix, de Salon, d'Apt, de Toulon et l'arrondissement de Grasse ; le « niçois » dans Nice et ses environs (le fleuve Var sert de frontière avec le maritime) ; l'« alpin » autour de Digne qui est une zone de transition entre les parties nord-occitane (rhodano-alpine) et méridionale (maritime, niçois). Mistral exclu du dialecte provençal le « vivaro-alpin », qu'il nomme « dauphinois » et sous-divise en : « briançonnais », « diois », « valentinois » et « vivarais »[A 1].
Pour Jules Ronjat, le « provençal général »[alpha 6] est constitué du maritime, du rhodanien et du niçois.
Jacques Allières estime qu'on peut parler d'ensemble dialectal provençal dans l'espace regroupant l'intégralité de l'occitan oriental.
Enfin, Pierre Bec classe le provençal (niçois compris) avec le languedocien au sein d'un dialecte « occitan méridional » (ou occitan moyen). À noter qu'avant le XVIe siècle, provençal et languedocien ne se distinguaient guère et formaient ce que l'on nomme « provençal moyen ».
- Dialectes de l'occitan selon Frédéric Mistral.
- Les dialectes de l'occitan selon Jules Ronjat.
- Les dialectes de l'occitan selon Jacques Allières.
- Dialectes de l'occitan selon Pierre Bec.
- Classification supradialectale avec arverno-méditerranéen (Bec, Sumien, etc).
L'universitaire provençal Guy Martin parle dans son livre « Grammaire provençale » d'un « occitan oriental » reprenant des délimitations similaires à celles proposées par Allières. En présentant le dialecte nord-occitan dans sa partie orientale comme un dialecte « difficilement séparable sur le plan socio-linguistique vis-à-vis de celui sud-occitan oriental compte tenu que la Provence s'étendait autrefois sur ce territoire mais indissociable sur le plan géo-linguistique avec le limousin et l'auvergnat », il n'opère pas de distinction particulière entre ce que Mistral appelle « dialecte provençal » (sud-occitan) et « dialecte dauphinois » (nord-occitan) mais, à la différence de Mistral, il nomme la partie nord-occitane orientale « dialecte rhodano-alpin » (ou « vivaro-alpin ») et la partie sud-occitane orientale en « dialecte rhodano-méditerranéen » en gardant les délimitations mistraliennes (alpin, marseillais, niçois, rhodanien). Ainsi, Martin divise les parlers provençaux de l'arc alpin en trois sous-dialectes : l'« intra-alpin » (central, méridional, septentrional) ; le « nord-rhodanien » (méridional, septentrional) et l'« inalpin » (ou « transalpin »). Il fait de même avec les parlers maritimes (« occidental », « varois », « oriental »), niçois (« côtier », « intérieur », « oriental »), et bas-rhodaniens (« central », « oriental », « occidental », « septentrional ») et dégage une « zone d'interférence » entre les dialectes rhodanien et maritime, et entre les dialectes maritime et alpin.
![La Provence linguistique et historique
Délimitation linguistique :
1 Limite de la langue occitane
2 Limite de dialecte
3 Limite de sous-dialecte
Délimitation historique :
4 « Limite de la langue provençale » selon le point de vue de Philippe Blanchet[11],[19] :
a « La Provence historique et culturelle »
b « Zones extérieures de culture provençale »
c « Zone historique provençale ayant appartenu au Piémont de 1388 à 1713 et surtout de culture alpine »
d « Zone dauphinoise aujourd'hui rattachée à la région Provence Alpes Côte d'Azur »
e « Pays niçois (Provençal jusqu'en 1388, Piémontais jusqu'en 1860, aujourd'hui rattaché à la région Provence Alpes Côte d'Azur »](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/af/Proven%C3%A7a_istorica_e_ling%C3%BCistica.png/300px-Proven%C3%A7a_istorica_e_ling%C3%BCistica.png)
Délimitation linguistique :
1 Limite de la langue occitane
2 Limite de dialecte
3 Limite de sous-dialecte
Délimitation historique :
4 « Limite de la langue provençale » selon le point de vue de Philippe Blanchet[11],[19] :
a « La Provence historique et culturelle »
b « Zones extérieures de culture provençale »
c « Zone historique provençale ayant appartenu au Piémont de 1388 à 1713 et surtout de culture alpine »
d « Zone dauphinoise aujourd'hui rattachée à la région Provence Alpes Côte d'Azur »
e « Pays niçois (Provençal jusqu'en 1388, Piémontais jusqu'en 1860, aujourd'hui rattaché à la région Provence Alpes Côte d'Azur »
Si nous laissons de côté l'utilisation de provençal pour désigner l'ensemble d'oc, l'extension du provençal reste un objet de débat :
- L'usage de la majorité des linguistes et de l'Unesco consiste à réduire son extension au « dialecte provençal » tel que défini par Pierre Bec[20] (appelé « sud-provençal » par Jean-Claude Bouvier).
- La tradition romaniste a longtemps inclus le vivaro-alpin dans le provençal. C'est par exemple le cas de Robert Lafont qui inclut ce dialecte — sous l'appellation « provençal alpin » — dans le provençal auquel il adapte la graphie classique de l'occitan[21] ou de Jean-Claude Bouvier, qui dans sa description du provençal, le nomme « nord-provençal ».
- L'école désignant le provençal comme une langue indépendante du reste du domaine d'oc inclut également (sous la désignation de « provençal alpin ») l'essentiel du domaine vivaro-alpin (sauf la rive droite du Rhône, appelée « vivarois ») et le niçois. L'inclusion des parlers des Alpes dans le provençal s'explique davantage par référence à la grande Provence historique et à la conscience linguistique des usagers que par la typologie linguistique. La variation importante qu'implique ce regroupement a amené la réutilisation du concept de langue polynomique apparu à l'origine pour le corse[11].
- La place du niçois dans le provençal fait aussi débat.[réf. nécessaire]
- Les parlers de transition avec le ligure (mentonasque, royasque, brigasque) font aussi l'objet de débats.
Hormis le vivaro-alpin et le niçois, le domaine du provençal est en général subdivisé en deux : le provençal rhodanien (rendu célèbre par Frédéric Mistral) et le provençal maritime (la langue de Victor Gelu).
Phonologie
La plupart des caractéristiques linguistiques, dont la somme est spécifique du provençal par rapport aux dialectes occitans voisins, apparaissent entre le XVIe siècle et le XVIIe siècle[22].
- Diversification des articles définis : en provençal les articles définis singuliers sont lou (graphie mistralienne) lo (graphie classique) [lu] et « l' » (devant une voyelle) au masculin (sou / so [su] existe dans les Alpes-Maritimes, à Grasse et dans les Alpes-de-Haute-Provence à Castellane ; sel est quant à lui utilisé devant une voyelle), la [la] et l' (devant une voyelle) au féminin (sa dans les Alpes-Maritimes, à Castellane et à Grasse) ; si les articles définis pluriels li(s) [li]~[lij] (rhodanien), lei(s) [lej] (maritime) et sei(s) [sej] (Alpes-Maritimes, Castellane, Grasse ; s' devant une voyelle) sont épicènes, en niçois on utilise lu [ly] au masculin pluriel et li [li] au féminin pluriel. La norme classique préconise l'article lei(s) en provençal. Toutefois, certains occitanistes comme Robert Lafont préfèrent, tout en respectant les généralités de l'écriture classique, utiliser li(s) et ainsi mieux respecter le dialecte rhodanien.
- Vocalisation des « -l »finaux en [w] : « soulèu / soleu [sulɛw] pour « soleil » alors que le latin populaire soliculus s'est souvent transformé en conservant le « l » final comme en français et en languedocien sau [saw] pour « sel » (comme en gascon et dans une large partie du nord-occitan).
- Diphtongaison des « o / ò » toniques dans une grande partie du domaine (généralisée contrairement au gascon et au languedocien où ce phénomène est localisé)[alpha 7].
- Maintien de la distinction entre [v] et [b], commune avec le nord-occitan, alors que languedocien et gascon confondent généralement les deux phonèmes en [β] (bêtacisme).
- Maintien de la prononciation des « -n » finaux, avec nasalisation partielle de la voyelle antérieure, le phonème n'étant maintenu que dans un nombre relativement réduit de termes dans les autres dialectes : pichoun / pichon > [piˈt͡ʃũᵑ] contre [piˈt͡ʃu] en languedocien.
- Maintien du « r » intermédiaire [ɾ] qui remplaça le « l » (soldat > sourdat / sordat).
- Prononciation « -ien » du « -ion » final dans le dialecte maritime (poupulacien contre poupulacioun / populacion « population »). La norme mistralienne écrit « -ien » mais la norme classique oralise cette différence. Certains classicistes tendent à écrire « -ien » et pas uniquement « -ion » comme le préconisent les universitaires.
- En provençal, la plupart des consonnes finales étymologiques et morphologiques ne sont pas articulées. C'est notamment le cas des marques grammaticales comme les « -s » du pluriel des noms et des adjectifs, qui disparaissent ou sont remplacées par des « -(e)i », contrairement au reste de l'occitan (exemple : lei bèlei filhas / l(e)i bèll(e)i fiho, le « -s » final étant amuï)[alpha 8]. Frédéric Mistral précise l'évolution du pluriel en provençal dans son dictionnaire[A 2] : d'abord, on écrivait en ancien provençal de bellas mans qui se rapproche aujourd'hui de l'alpin et du languedocien dont l'origine dialectale était autrefois unitaire, cette forme se transforma ensuite en de bellai man ce qui correspond là encore à une évolution plus diphtonguée (autre exemple : mas > mai ; également conservé en alpin et en languedocien), il s'ensuivit l'évolution encore présente dans le sous-dialecte maritime actuel de bèllei man, le phénomène se poursuivit en rhodanien de bèlli man avec la suppression du « -s » muet du pluriel (sauf en liaison avec une voyelle dans le mot suivant) et l’amuïssement du « -e » — qui sera supprimé par simplification orthographique — au profit du « -i ». Les classicistes écrivent la forme standard du provençal en de bèlei mans où « ei » doit être prononcé [ej] en maritime et [i]~[ij] en rhodanien dans un souci de renforcement de l'unité du dialecte provençal.
Voyelles
Tous les dialectes provençaux possèdent les phonèmes vocaliques [i], [y], [e], [ɛ], [a], [u], [o] et [ɔ]. Leur utilisation est variable selon les localités. Le rhodanien possède en plus le phonème [ø] et le vivaro-alpin les phonèmes [œ] et [ə].
| Antérieures | Centrales | Postérieures | ||
|---|---|---|---|---|
| Fermées | i | y | u | |
| Mi-fermées | e | ø | o | |
| Moyennes | ə | |||
| Mi-ouvertes | ɛ | œ | ɔ | |
| Ouvertes | a | |||
Consonnes
Tous les dialectes provençaux possèdent les phonèmes consonatiques [m], [b], [p], [f], [v], [ɥ], [n], [t], [d], [s], [z], [ɾ], [l], [ɲ], [j], [ŋ], [k], [g], [w] et [ʁ]. Leur utilisation est variable selon les localités. Le vivaro-alpin est le seul à posséder les phonèmes [θ], [ð], [ʒ], [ʃ] et [ʎ] ; le maritime et le niçois et le sud-rhodanien ont les affriquées [t͡ʃ] et [d͡ʒ] contrairement au nord-rhodanien qui a [t͡s] et [d͡z].
| Bilabiales | Labio-dentales | Labio-palatales | Dentales | Alvéolaires | Palato-alvéolaires | Palatales | Vélaires | Labio-vélaires | Uvulaires | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasales | m | n | ɲ | ŋ | ||||||||||||
| Occlusives | p | b | t | d | k | ɡ | ||||||||||
| Affriquées | t͡s | d͡z | t͡ʃ | d͡ʒ | ||||||||||||
| Fricatives | f | v | θ | ð | s | z | ʃ | ʒ | ʁ | |||||||
| Spirantes | ɥ | j | w | |||||||||||||
| Battues | ɾ | |||||||||||||||
| Spirantes latérales | l | ʎ | ||||||||||||||
Diphtongues et triphtongues
Diphtongues
Les diphtongues provençales sont [aj], [ej], [ɛj], [ɔj], [uj], [aw], [ɛw], [ew], [iw], [ɔw], [ow], [ja], [jɛ] [je], [jɔ], [jœ] ,[ju], [ɥe] et [ɥœ][23]. Leur orthographe a varié selon les auteurs et les époques : les auteurs de la Renaissance, par exemple, utilisaient la lettre « y » (« rey » au lieu de « rei ») que les troubadours n'employaient pas[B 1] et qu'aucun courant moderne de normalisation n'a repris.
Les variations dans la notation des diphtongues entre les écritures classique et mistralienne sont superficielles et tiennent pour certaines seulement par l'apparition ou la suppression d'un accent. En graphie classique et mistralienne elles s'écrivent respectivement[24],[B 2] :
| Graphie classique | Graphie mistralienne | Prononciation |
|---|---|---|
| ai | ai | /aj/ ou /ej |
| ei | ei | /ej/ |
| èi | èi | /ɛj/ |
| òi | oi | /ɔj/ |
| oi, ói, oï, oí, vò | oui | /uj/[c 1],[c 2] |
| au | au | /aw/ |
| èu | èu | /ɛw/ |
| eu | éu | /ew/[c 3] |
| ièu | iéu | /iw/[c 4] |
| òu | òu | /ɔw/ |
| ou | óu | /ow/ |
| ue | ue | /ɥe/ en maritime[c 5]
/jœ/ en rhodanien[c 6] |
| uò | uò | /jɔ/ en rhodanien[c 7] |
- Plus localement, on retrouve les prononciations wej ou wɛj.
- La diphtongue « oui » en norme mistralienne résulte d'une francisation du « o » - prononcé u dans la langue d'oc ancienne que reprend la norme classique.
- Parfois réalisé yw voire œw.
- Entre Arles et Marseille, elle se prononce souvent jew. La normalisation mistralienne a généralisé la notation « iéu » à toute la Provence.
- En maritime, elle est parfois prononcée ɥœ.
- En rhodanien, elle est prononcée œ notamment après une consonne suivie de ʁ ou l.
- Les autres sous-dialectes provençaux ne possèdent pas ce son et le remplacent par ɥe (fuòc fjɔ devint ainsi fuec fɥe(k)).
Les diphtongues changent de valeur selon leur tonicité. Lorsque « ai » et « au » sont toniques elles se prononcent aj et aw (aiga 'aigɔ, sauvar 'sawva), quand elles sont atones ej et ow (aiguier ej'gje, sauvança sow'vaŋsɔ). Elles peuvent aussi se prononcer ij, i et uw, mais également u, notamment en rhodanien. Ces prononciations en ij et i très présentes dans le sous-dialecte rhodanien concernent la finale atone -ei(s) des pluriels (articles, adjectifs, pronoms). Exemple : nosautrei nu'zawtʁi.
L'utilisation du tréma indique l'absence de diphtongue (diérèse) et la prononciation de la syllabe à l'unité. Exemple : flaüta fla'ytɔ.
En écriture classique, les « o » en début de mot peuvent se prononcer [u] mais la prononciation tend généralement à les diphtonguer en « ow » comme oliva > óulivo ; observatòri > óusservatori ; occitan > óucitan. Cette diphtongue est uniquement oralisée en écriture classique.
Triphtongues
Grammaire
Phonétique
Voyelles
| Graphème classique | Graphème mistralien | Prononciation commune | Prononciation locale différenciée |
|---|---|---|---|
| a en général | a | [a] | |
| -a final, atone (féminin) | -o | [ɔ] |
Dans le langage courant, les prononciations [ɔ], [œ] et [a] tendent à se confondre. À ce titre, Frédéric Mistral émettait l'hypothèse que les Niçois pouvaient adopter -o à l'écrit comme le reste des Provençaux[B 2]. D'ailleurs, le Niçois Jean Badat utilisait parfois -o dans son journal : « Tant sagiament foget menado la causo che monsur foget signour como esi so es che non serio si si fosco menat autroment ero perdut tot lo rest de som pais »[25]. Philippe Blanchet montre que la lettre -e fut employée temporairement à Marseille «...Aguet doües coüestes enfonçades... »[11]. En chanson, les lettres finales atones sont souvent appuyées. |
| -as final, terminaison atone | -as | [ɔs] |
|
| -an final, terminaison tonique | -an | [aⁿ] ([an] dans certains mots internationaux) | |
| -an final, terminaison atone dans les verbes à la 3e personne du pluriel | -on | [ɔn] | |
| à | a | [a] | |
| á | é | [ɔ], [e] |
|
| ai | ai, ei | [aj], [ej] |
|
| au | au, óu | [aw], [ɔw] |
|
| è | è | [ɛ] | |
| é | é | [e] | |
| e | e, a, i, u | [e], [a], [i], [y], [œ] |
|
| i | i | [i] [j] après une voyelle [i] ou [j] avant une voyelle |
|
| í | i | [i] | |
| -ion final | -ioun, -ien | [juⁿ] |
|
| ò | o, ò, oua, oue, ouo | [ɔ] |
Pour -ò la prononciation est identique au a/o final atone des écritures classique et mistralienne.
|
| ó | ou | [u] | Entre Marseille et Toulon, la lettre se prononce [ɔ] si elle est suivie d'un -r. |
| o | ou | [u] | Entre Marseille et Toulon, la lettre se prononce [ɔ] si elle est suivie d'un -r. |
| u | u | [y] [w] après une voyelle [y] ou [ɥ] devant une voyelle |
Il faut noter qu'entre la graphie classique et mistralienne, la prononciation reste quasiment la même. Certaines lettres se prononcent toutefois différemment en fonction de la graphie utilisée.
- A : Elle se prononce comme en français, sauf si elle est atone et en position finale, ce qui produit un son entre le -a et le -o, ressemblant au -o ouvert de « sort » ([ɔ]) notamment lorsque l'on appuie sur la lettre finale comme dans les chansons mais dans le langage courant le son est proche du -e français (annada/annado se prononce couramment annade). C'est pour cette raison que la graphie mistralienne emploie la lettre -o, et la graphie classique utilise -a. La plupart des chansons contemporaines comportent parfois des erreurs, avec un -o trop prononcé, proche du français « eau »
- E : se prononce [e] comme « é » en français. En écriture classique, selon les lettres qui la suivent, elle peut se prononcer -i, -u, -a, -é. Toujours selon l'écriture classique, un « e » se prononce « i » en provençal maritime lorsqu'il est suivi de « nh » (senhor) ou « lh » (Marselha) mais aussi après un « ch » (pròche) ou un « tg » (metge) ; alors qu'en provençal rhodanien, ce « e » se prononce comme dans le « eu » dans « jeune ». En maritime, « e » peut aussi se prononcer [a] lorsqu'il est suivi d'un r combiné avec une consonne (mercat). Entre Arles et Marseille,« e »devient « u » ([y] lorsqu'il est suivi par « b », « p », « f », « v », « m » (frema). Pour simplifier cette règle, certains utilisateurs de l'écriture classique appliquent la règle de Roumanille et écrivent « Marsilha », « fruma » et « marcat ».
- U : se prononce [y] comme en français mais se transforme en -ou [u] après une diphtongue (-au, -eu, -iu, etc.). On retrouve plus fréquemment la prononciation du -iu en -iéu autour du Rhône. Cette diphtongue peut se retrouver dans de nombreux toponymes provençaux francisés comme « riou » et « rieu ». L'écriture classique généralise l'écriture originelle -iu tandis que l'écriture mistralienne, plutôt centrée sur le rhodanien, généralise l'écriture -iéu.
- O : en graphie classique la lettre « o » non accentuée équivaut au -ou de l'écriture mistralienne (prononcé [u] dans les deux écritures).
Dans la graphie classique, -o et -ó équivalent au -ou français ([u]), et -ò correspond au -o français. Toutefois, -ò sert également à préciser l'emplacement des diphtongues (oralisées en écriture classique) : -oua (varois - chez Mistral cela comprend l'arrondissement de Grasse), -ouo (niçois), -oue (aixois et marseillais), que les rhodaniens ne prononcent pas car ils se limitent à la prononciation [ɔ].
En début de mot, -o se prononce souvent [ow] (« oliva » [owlivɔ] que les mistraliens écrivent « óulivo » identifiable avec l'accent aigu sur -ó). Dans cet exemple, la graphie classique se veut plus fidèle aux textes anciens, même si au Moyen Âge les troubadours ne mettaient pas d'accent sur -o. À l'inverse, la graphie félibréenne est plus proche de la langue de la koinè pour certains termes comme Mars (Marts) ou Laurens que les la graphie classique qui écrit par analogie avec le catalan Març (Marts) et Laurenç (Laurens).
Consonnes
| Graphème classique | Graphème mistralien | Prononciation commune | Prononciation régionale différenciée |
|---|---|---|---|
| b | b | [b] | |
| -b final | -b | [p] dans les mots internationaux) | |
| c | c | [k] [s] devant e, i | |
| -c final | -c | [k] |
|
| ç | ç, ss | [s] devant a, o, u | |
| -ç final | s | [s] (mais muet après une diphtongue ou un -r ; exemple : març) | |
| cc placés devant e, i | c, cc | [ks (s)] | |
| d | d | [d] | |
| -d final | -d | [t], muet |
|
| dd | d | [d] | |
| f | f | [f] | |
| g | g | [g], [d͡ʒ] |
|
| -g final | muet | ||
| gu devant e, i | gu | [g] | |
| j | j | [d͡ʒ], [d͡z] |
|
| l | l | [l], [ɾ] | En maritime, le -l suivi d'une consonne se prononce parfois comme un -r roulé (les deux sons se mélangent). Par exemple, cultura et soudat (« soldat » avant vocalisation du -l en -u) se prononce [kuɾtuɾa] et [suɾda] en roulant légèrement les -r (plus exactement en les battant). Les deux graphies admettent les deux formes. |
| -l- entre deux voyelles | l, r | [l], [ɾ] |
Frédéric Mistral explique à l'entrée « L » de son dictionnaire qu'un « l » intermédiaire en maritime et en alpin se permute souvent avec un « r ».
|
| -l final | -u (parfois) | [l], muet |
Dans la majeure partie des dialectes, -l final est muet dans un mot paroxyton. |
| ll | l | [l] | |
| m | m | [m] en général [ⁿ] [m], [ⁿ] devant une consonne (semi-nasalisation de la voyelle précédente) |
|
| -m final | -n | [ⁿ] (semi-nasalisation de la voyelle précédente), [m], [ⁿ] |
|
| mm | m | [m] | |
| n | n | [n], [ⁿ] devant une consonne (semi-nasalisation de la voyelle précédente) | |
| -n final | -n | [ⁿ] (semi-nasalisation de la voyelle précédente) | |
| nn | n | [n] | |
| -nd final -nt final | -d -t | [ⁿ], [ⁿt, ⁿ], [ⁿt] |
|
| p | p | [p] | |
| -p final | p | [p], [w], muet |
|
| qu | qu, c, k (quelques mots) | [k] | |
| r | r, l | [ɾ] apicale brève (battue) [ʁ] |
|
| rr entre deux voyelles | rr | [ʁ], [ɾ] |
|
| -r final | -r | [ʀ] (partiellement muet), [ɾ] |
|
| -rm final | -r | [ʀ], [ɾm] |
|
| -rn final | -r | [ʀ], [ʀp], [ɾn] |
|
| s | s | [s] [z] entre deux voyelles | |
| -s final | -s | [s], [z] en liaison |
|
| ss entre deux voyelles | ss | [s] | |
| t | t | [t] | |
| -t final | t | [t] muet dans les adverbes en -ment. muet dans les participes présents. |
|
| tg devant e, i tj devant a, o, u | g devant e, i j devant a, o, u | [d͡ʒ], [d͡z] |
|
| tz entre deux voyelles | s | [d͡z], [z] |
|
| v | v | [v] | |
| x | ss | [ks (s)], [gz (z)], [s] |
|
| z | z, s | [z] |
La prononciation des consonnes finales dans le dialecte provençal est fluctuante. Dans les sous-dialectes rhodanien et maritime, celles-ci tendent le plus souvent à s’amuïr et c'est pour cette raison que l'écriture mistralienne, calquée sur le rhodanien, tend à les enlever. Par exemple, le -at final désignant le participe passé s'écrit -a en mistralien (proussimita) - contre -at en classique (proximitat). Étant donné que les sous-dialectes niçois et alpin sont plus conservateurs dans la prononciation des consonnes finales, comme certains autres dialectes occitans, l'écriture classique tend à les remettre afin d'unifier au mieux la langue d'oc. Les dialectes sont ainsi davantage oralisés (écriture classique) que transcrits (écriture mistralienne).
- B : se prononce comme en français et remplace parfois la lettre -v comme pour trabalh (clas) / trabai (mist) « travail » qui provient du latin travallum et écrit en ancien occitan trabal, trebalh, trebaill, etc.
- C et P : en position finale elles se prononcent essentiellement en Provence orientale et alpine.
- H : plus courant jadis (home > òme) n'est conservé que dans les diagrammes « lh », « nh » et « ch ». L'écriture mistralienne l'emploie aussi mais plus rarement (« lh » y est conservé dans le Languedoc mais la prononciation diffère du provençal classique) ; dans cette écriture, « lh » est souvent remplacé par un « i » (fuelha > fueio) ou un simple « h » (brilha > briha) selon que la syllabe est tonique ou atone, alors que « nh », qui a inspiré la langue portugaise, a été remplacé par « gn » comme en italien et en français (banha > bagna).
- L et R : se prononcent comme en français sauf en maritime et alpin (mais aussi dans l'Hérault et en gascon) où un -l entre deux voyelles se prononce souvent [ɾ] apico-dental faiblement battu (comme le -r entre deux voyelles, similaire au -r italien). C'est pour cela que la norme félibréenne qui fixe la règle « un r entre deux voyelles vaut [ɾ] » accepte les doublets « poulit »/« pourit » et « salado »/« sarado » là où la norme classique note « polit » (joli, gentil) et « salada » (salade). En effet, Mistral précise que le -r seul, y compris entre deux voyelles, se prononce faiblement battu presque comme un -l ; -l et le -r ont ainsi tendance à voir leur prononciation se confondre dans ces cas. Lorsque deux -r se suivent, il se prononce comme en français. Le -r final, réintroduit dans les infinitifs en écriture classique (cantar, tenir, etc.) est muet, sauf en vivaro-alpin. Cependant, chez les félibres il est essentiellement prononcé dans les mots à monosyllabiques (exemples : car, mar, etc.).
- N et M : elles ont la même prononciation (-n nasal), sauf à l'initial.
- S : est très variable. Elle tend généralement à se prononcer sauf dans les formes du pluriel ou dans la plupart des noms de lieux et communes.
Les consonnes « k » et « w » sont absentes de l'écriture classique. La première est remplacée par « qu » (kilo > quilò) ou « c » (kabyle > cabile) alors que la seconde est remplacée par « v » (Wikipédia > Viquipedia). L'écriture mistralienne n'utilise également pas « w » mais emploie « k » pour douze mots dans le dictionnaire provençal-français de Frédéric Mistral : karabe (succin, ambre jaune) ; kaulin (kaolin) ; kepi (képi) ; kermés (kermès) ; Kerounièio (Chéronée) ; kersounèso (chersonèse) ; kilougramo (kilogramme) ; kiloumètre (kilomètre) ; kinarredoun (cynorrhodon) ; kirié (kyrie) ; kiriello (kyrielle) et kirsch (kirsch). L'auteur précise d'ailleurs que cette lettre est presque inusitée en langue d'oc moderne et était plus employée dans l'ancien occitan. C'est prétendument dans un souci de simplification que les classicistes ont remplacé la lettre « k »[réf. nécessaire].
- X : la lettre « x » est particulière. Étant donné que l'écriture mistralienne tend à baser l'écriture des dialectes sur la prononciation, elle restreint sa prononciation au son [ks] comme dans le languedocien « prouximitat » prononcé [pruksimi'tat] (correspondant au groupe consonantique -cs). Frédéric Mistral indique que les « provençaux ne se servent jamais de cette lettre » et qu' « ils la remplacent par s ou ss ». Les occitanistes ont choisi de généraliser l'utilisation de la lettre -x mais en lui donnant différentes prononciations comme en français. Ainsi, en écriture classique « proximitat » se prononce [pʁusimi'ta] en provençal (-x identique à celui de Bruxelles) et [pruksimi'tat] en languedocien. Entre deux voyelles, « x » peut se prononcer [z] ou [jz] comme dans exercici [ejzeʁ'sisi / ezeʁ'sisi].
Digrammes
| Graphème classique | Graphème mistralien | Prononciation commune | Prononciation locale différenciée | Exemple | Prononciation de l'exemple |
|---|---|---|---|---|---|
| ch en général | ch | [t͡ʃ] | nord-rhodanien : [t͡s] | Cla. : chichí fregit Mist. : chichi fregi | t͡ʃi't͡ʃi fʀe'd͡ʒi |
| ch en final | ch | [t͡ʃ], muet | Le -ch final est supprimé dans l'écriture mistralienne pour le maritime et le rhodanien. vivaro-alpin, niçois : [t͡ʃ] | Cla. : nuech Mist. : nue, niue, nuech, niuech | nɥe, niœ, nɥet͡ʃ, niœt͡ʃ |
| lh en général | lh, i(h) | [j], [ʎ] | maritime, niçois, rhodanien : [j] vivaro-alpin, maritime (rare) : [ʎ] | Cla. : Marselha, Fuelha Mist. : Marsiho, Fiuelho (varois) | masi'jɔ, fɥejɔ/fiœʎɔ |
| lh en final | lh, u, i | [l], [w], [j] | maritime, rhodanien : [w] (vocalisation fréquente mais non systématique) maritime, niçois : [j] vivaro-alpin : [l] | Cla. : uelh Mist. : uei | ɥej |
| nh, gn en général | gn | [ɲ] | Cla. : montanha, ignòble Mist. : mountagno, ignoble | muⁿ'taɲɔ, iɲɔble | |
| nh en final | n | [ⁿ], [ɲ] | maritime, rhodanien, niçois : [ⁿ] vivaro-alpin : [ɲ] | Cla. : banh Mist. : ban | baⁿ |
| tz en général | s | [s] | Class. : crotz Mist. : crous | kʀus |
Les digrammes en écriture classique sont les suivants :
- CH :se prononce [t͡ʃ] en maritime comme dans pichon [pit͡ʃun] et [t͡s] en rhodanien comme dans pichòt [pitsɔ].
- LH : se prononce toujours en (j) sauf parfois en fin de mot où il peut être amuï. Il se prononçait autrefois [ʎ] comme « gl » en italien et se conserve essentiellement en languedocien et en vivaro-alpin. Il était encore sporadiquement conservé dans quelques mots en provençal moderne comme dans le parler varois du sous-dialecte maritime qui note fiuelho[A 3] pour « feuille » contre fueio dans le provençal standard de la norme mistralienne.
- NH : se prononce toujours [ɲ] (comme le français « montagne » qui s'écrit montanha en occitan) sauf en position finale où il se prononce [ŋ] comme dans pan.
- GN : se prononce parfois [ɲ]. Exemples : digne, ignorar, signar, etc.
- TZ : se prononce [s]
L'écriture félibréenne emploie de « ch » mais a transformé les autres. Ainsi, l'écriture traditionnelle -tz passe à -s, -nh à -gn et -lh passe fréquemment à -i ou -h, mais se maintient dans de rares mots provençaux très localisés et s'emploie à l'écrit dans d'autres dialectes de l'occitan.
Groupes de consonnes
Dans un souci d'une meilleure réunification à l'écrit de la langue d'oc et par calque de l'orthographe catalane, l'écriture classique réemploie certaines consonnes doubles se prononçant dans des dialectes particuliers et que l'écriture mistralienne a supprimé par simplification orthographique (seulement pour le provençal standard).
| Graphème classique | Graphème mistralien | Prononciation commune | Exemple | Prononciation de l'exemple |
|---|---|---|---|---|
| bd, gd | d | [d] | Cla. : ebdomadari Mist. : edoumadari | edumadaɾi |
| tl | l | [l] | Cla. : espatla Mist. : espalo | ɛspalɔ |
| dm, gm, tm | m | [m] | Cla. : setmana Mist. : semano | semanɔ |
| bn, gn, mn, tn | n | [n] | Cla. : condamnar Mist. : coundana | kuⁿdana |
| bs, cs, ns, ps, rs | s | [s] | Cla. : psicologia, accent, inspirar, constatar Mist. : sicoulougio, acènt, ispira, coustata | sikulud͡ʒi, aceⁿ, ispiɾa, kustata |
| bt, ct, pt | t | [t] | Cla. : subtilitat, acte Mist. : sutileta, ate | sytilita/sytileta, ate |
| bv, dv | v | [v] | Clas. : adversari Mist. : aversàri | avesaɾi |
Quand deux consonnes se suivent, les deux graphies ne prononcent que la seconde. Cependant, la première propose une autre solution en vocalisant les premières consonnes comme -b, -c, -g, -p en -w. Exemples : absolut [owsu'ly], adoptar [adow'ta]. Elle propose aussi la transformation de -c en [j] après -e et -è. Exemples : lectura [lej'tyrɔ], objectar [owdʒj'ta].
Le dictionnaire provençal-français du CREO-Provença (IEO) précise que des débats existent quant au maintien de certains groupes consonantiques du fait de l'alourdissement qu'ils peuvent générer. Ainsi, là où le -t de setmana peut-être facilement assimilable comme dans viatjar, le -p dans psicologia et le -ns dans constatar le sont moins. C'est pourquoi, précise l'ouvrage, certains classicistes écrivent sicologia, costatar ect.
Articles
Les dialectes provençaux partagent les articles définis singuliers lou (lo en graphie classique) au masculin[B 3] et la au féminin[B 4] (ils s'élident devant une voyelle). En niçois, on peut également trouver après la préposition eme / embe (« avec ») les articles ei, ai et au à la place de lou[E 1]. Au pluriel, le rhodanien possède li(s) (orthographié lei(s) en graphie classique) le maritime lei(s)[B 5], le niçois lu au masculin et li au féminin[E 2], le vivaro-alpin lous (los en graphie classique), les et lei (par influence des parlers de la plaine) au masculin et las au féminin. Dans le massif alpin, les formes rou et ra (phénomène de rhotacisme) existent aussi. Dans les Alpes-Maritimes (vers Coaraze et Roquestéron), à Grasse et à Castellane on retrouve aussi les articles définis sou (so en graphie classique) et sel (seulement devant une voyelle) au masculin, sa au féminin, sei(s) au pluriel. Sur le même modèle, les articles indéfinis sont un au masculin, uno (una en graphie classique) au féminin, di(s) au pluriel en rhodanien (aligné sur le maritime dei(s) en graphie classique), de en niçois. Quant à uni(s) et unei(s) ils s'emploient pour parler de choses doubles[B 6].
Chez Brueys, qui écrivait à Aix vers 1600, on trouve tantôt leis (leis damos, leis omes) tantôt las (las terros, las fremos).[réf. souhaitée]
| Graphie mistralienne | Graphie classique | |||
|---|---|---|---|---|
| Masculin | Féminin | Masculin | Féminin | |
| Article défini singulier | Lou, L' | La, L' | Lo, L' | La, L' |
| Article défini pluriel | Li(s), Lei(s), Lu | Li(s), Lei(s), Li | Lei(s), Lu | Lei(s), Li |
| Article indéfini singulier | Un | Uno | Un | Una |
| Article indéfini pluriel | Di(s), Dei(s), De | Dei(s), De | ||
Nombres
En ancien occitan, le marqueur du pluriel pour les substantifs était un « -s » final que les dialectes maritime, niçois et rhodanien ne prononcent plus — sauf liaison — contrairement au vivaro-alpin qui l'a maintenu. Ainsi, pour les trois premiers sous-dialectes seul l'article permet désormais d'identifier à l'oral si la forme est au singulier ou au pluriel. La graphie mistralienne ne note pas ce « -s » lorsqu'il est inaudible ; les substantifs peuvent alors sembler invariables : la poumo, lei poumo. La graphie classique l'écrit systématiquement. Pour les adjectifs, la marque du pluriel est soit « -s » ou « -ei(s) » (« -i(s) » en rhodanien et en niçois) selon leur position dans la phrase : deis òme braves, de braveis òmes. C'est lorsque l'adjectif est placé devant le nom auquel il se rapporte qu'il se termine par « -ei(s) ». Toutefois certains adjectifs comme bèu (« beau »), bòn (« bon ») et pichon (« petit ») possèdent une flexion complète que le tableau ci-dessous récapitule (les formes en graphies mistralienne sont indiquées entre parenthèse) :
| Français | Masculin singulier | Féminin singulier | Masculin pluriel | Féminin pluriel |
|---|---|---|---|---|
| beau | bèu, bèl | bèla (bello) | bèi | bèlei (bellei/belli) |
| bon | bòn (bouan/bon) | bòna (bouano/bono) | bòi (bouei/boi) | bòni (bouanei/boni) |
| petit | pichon (pichoun) | pichona (pichouno) | pichoi (pichoui) | pichonei (pichounei/pichouni) |
Conjugaison
Les verbes provençaux sont rangés en trois groupes selon leur infinitif : le premier groupe fait ses terminaisons en « -ar » (« -a » en graphie mistralienne, « -à » traditionnellement en niçois), le deuxième en « -ir » (« -i » en graphie mistralienne, « -ì » traditionnellement en niçois) et le troisième en « -er » ou « -e » (« -e » ou « -é » en graphie mistralienne, « -e » traditionnellement en niçois).
Ci-dessous la conjugaison en rhodanien, maritime et niçois selon la norme classique avec entre parenthèse la norme mistralienne (sauf pour le niçois qui provient des écrits des anciens auteurs du Comté) lorsque des différences existent :
| Verbe | Présent de l'indicatif | Imparfait de l'indicatif | Prétérit | Futur de l'indicatif | Conditionnel présent | Subjonctif présent | Subjonctif imparfait | Impératif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier groupe : |
Ame |
Amave |
Amère |
Amarai |
Amariáu (Amariéu) |
Ame |
Amèsse |
Ama (Amo) |
| Deuxième groupe : |
Sente (Sènte) |
Sentiáu (Sentiéu) |
Sentiguère |
Sentirai |
Sentiriáu (Sentiriéu) |
Sente (Sentigue) |
Sentiguèsse |
Sente (Sènte) |
| Troisième groupe : |
Pòde |
Podiáu (Poudièu) |
Posquère (Pousquère) |
Podrai (Poudrai) |
| Verbe | Présent de l'indicatif | Imparfait de l'indicatif | Prétérit | Futur de l'indicatif | Conditionnel présent | Subjonctif présent | Subjonctif imparfait | Impératif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier groupe : |
Ami (Àimi) |
Amavi (Eimàvi) |
Amèri (Eimèri) |
Amarai (Eimarai) |
Amariáu (Amariéu) |
Ami (Àimi) |
Amèssi (Eimèssi) |
Ama (Amo) |
| Deuxième groupe : |
Senti (Sènti) |
Sentiáu (Sentiéu) |
Sentèri |
Sentirai |
Sentiriáu (Sentiriéu) |
Senti (Sènti) |
Sentèssi |
Sente (Sènte) |
| Troisième groupe : |
Pòdi (Pouèdi) |
Podiáu (Poudièu) |
Poguèri (Pouguèri) |
Podrai (Poudrai) |
| Verbe | Présent de l'indicatif | Imparfait de l'indicatif | Prétérit | Futur de l'indicatif | Conditionnel présent | Subjonctif présent | Subjonctif imparfait | Impératif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier groupe : |
Aimi |
Amavi (Aimavi) |
Amèri (Aimeri) |
Amerai |
Aimerii |
Ami (Aimi) |
Amèssi (Aimèssi) |
Aima |
| Deuxième groupe :
Sentir/Sentì (sentir)[29] |
Senti |
Sentii |
Senteri |
Senterai |
Senterii |
Senti |
Sentessi |
Sente |
| Troisième groupe : |
Provençal parlé
Le provençal connaît à l'écrit comme à l'oral des variations locales, plus visibles en écriture mistralienne qui les valorise qu'en écriture classique qui les minimise pour les revaloriser dans le langage parlé. Voici un exemple de cette variation avec la traduction de la phrase « Les belles filles jouent tous les jours sur la colline » :
| Dialecte | Norme mistralienne | Norme classique | Prononciation phonétique |
|---|---|---|---|
| Maritime | « Lei bèllei fiho juegon toutei/touei lei jou(r) dins la coualo/couelo. » | « Lei bèlei filhas jògan totei/toei lei jorns dins la còla. » | lej bɛlej fijɔ d͡ʒueguⁿ tutej/tuej lej d͡ʒu(r) diⁿ la kualɔ/kuelɔ |
| Niçois | « Li beli filha juègon toui lu jou dins la couòla. » | « Li bèli filhas jògan toi lu jorns dins la còla. » | li bɛli fija d͡ʒuɛguⁿ tuj ly d͡ʒu diⁿ la kuala/kuɔla |
| Rhodanien | « Li bèlli chato jogon tóuti li jour dins la colo. » | « Lei bèli chatas jògan toti li jorns dins la còla. » | li bɛli t͡satɔ d͡zɔgu tuti li d͡zur diⁿ la kɔlɔ |
Le maritime
Le maritime, également nommé « central » ou « marseillais »[A 1], est parlé sur un territoire recouvrant les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes et du Var. Il possède deux variantes : le marseillais proprement dit et le varois plus influencé par sa proximité géographiques avec les dialectes niçois et alpin (l'arrondissement de Grasse est par exemple une zone de transition entre varois et niçois). Le maritime possède des caractéristiques propres : les pluriels des adjectifs se font en -ei(s) et non en -i(s) comme c'est le cas en rhodanien, les « o » toniques peuvent être diphtongués en « ouo » [wɔ], « oua » [wa] et « oue » [we][B 2] (la graphie classique ne note pas ce phénomène), les pronoms me, te, se deviennent en maritime — tout comme en niçois — mi, ti, si, la conjugaison diffère du rhodanien puisqu'au présent de l'indicatif, la terminaison de la première personne du singulier est « -i » et non « -e », la désinence des substantifs en « -ien » remplace celle en « -ion / -ioun » du rhodanien[B 10] (la graphie classique oralise cette différence et recommande d'écrire « -ion » par souci de pan-occitanité, mais certains classicistes perpétuent l'usage du « -ien » aussi bien à l'oral qu'à l'écrit[alpha 9]), la chute très marquée de nombreuses consonnes finales, la suppression de certaines consonnes intervocaliques, que ne connaît pas le rhodanien, induite par des contacts entre parlers de la plaine et parlers de la montagne lors des transhumances (ce phénomène est plus visible dans les zones inter-dialectales).
Le varois comporte des spécificités liées à la conservation de certaines caractéristiques propre à l'ancien provençal que l'on retrouve encore dans le sous-dialecte alpin de Digne ou le rhodano-alpin plus au nord. Ce maintien plus important d'archaïsmes s'explique par les migrations de population qu'a connu le Var depuis les Alpes-de-Haute-Provence et par les transhumances entre plaines et montagnes.
Le maritime de l'arrondissement de Grasse, est quasi identique au parler varois. Il ne se distingue que par la conservation de lettres consonantiques finales « -c » et « -p » à l'oral ainsi que par le maintien de « -ion / -ioun » en final au lieu de « -ien ».
Le niçois
Le niçois, (endonyme : niçart[30],[alpha 10] ou nissart[alpha 11]) se parle traditionnellement dans Nice et ses environs, bien qu'en ce XXIe siècle, le rayonnement de la ville et les migrations humaines font que l'usage de la langue déborde sur les zones alpines et maritimes voisines. L'appellation niçart recouvre deux réalités :
- une réalité linguistique car même si les linguistes rattachent ce dialecte au provençal, la langue possède des traits particuliers bien identifiés ;
- une perception géographique et sociolinguistique car le Comté de Nice qui fut longtemps séparé du reste de la Provence a développé une identité propre. Le rattachement du niçois aux autres dialectes provençaux est par conséquent parfois remis en cause par certaines personnes ou associations.
Étant donné que le niçois est le dialecte provençal qui a le moins divergé de l'ancien provençal et que ce qui est devenu le Comté de Nice a été séparé pendant un temps du reste de la Provence, il convient de traiter sa question dans une page plus spécifique.
Le rhodanien
Le rhodanien est parlé entre les villes d'Arles, Saint-Rémy-de-Provence, Cavaillon, Carpentras, Orange, Avignon, Nîmes et Beaucaire[31]. Les sous-dialectes locaux sont les parlers du Ventoux, du comtat (aux environs de Carpentras), de la vallée du Rhône (vers Nîmes, Arles, Avignon, Orange et Bollène). En rhodanien, les pluriels adjectivaux sont réduits à -i(s), les graphèmes « ch » et « j » (« g » devant « e » et « i ») se prononcent respectivement [t͡s] et [d͡z] en nord-rhodanien contrairement aux autres dialectes qui disent plutôt [t͡ʃ] et [d͡ʒ], les « o » toniques ne sont pas diphtongués, l'article pluriel est li(s) et non lei(s) (les classicistes rhodaniens écrivent « lei(s) » mais prononcent [li(s)], certains comme Robert Lafont simplifient et notent « li(s) » en accord avec leur prononciation[alpha 12]), la conjugaison possède ses propres spécificités.
Selon Jean-Pierre Tennevin, le dialecte rhodanien est celui qui, ayant subi le plus d'évolutions et « d'usures phonétiques », présente les sons les plus atténués, les « plus doux » à l'oreille[32].
Le shuadit ou judéo-provençal
Les « juifs du pape », communautés juives d'Avignon, de Carpentras, de Cavaillon, de l'Isle-sur-la-Sorgue et du Comtat Venaissin ont développé un dialecte judéo-provençal particulier, connu sous le nom de shuadit, se distinguant peu du provençal proprement dit, si ce n'est par quelques différences de prononciation et des termes propres au judaïsme. Le dernier locuteur connu, l'écrivain Armand Lunel, est décédé en 1977. Grâce aux lectures de Frédéric Mistral ainsi qu'à correspondance avec Albert Lunel et son petit-fils Armand, quelques termes shuadits sont présents dans le Trésor du Félibrige[33],[34] : aquire « là » ; cabussado « mikvé » ; coudolo « matsa » ; gouïn « goy » ; anlèt « talit », sagata « égorger », « rater la couture d'une étoffe »[35] ; sagataire « boucher kasher » ect.
Le vivaro-alpin
Le vivaro-alpin (aussi nommé « alpin », « gavot », « rhodano-alpin ») est parlé entre la haute vallée de la Loire et la plaine du Pô, dans un espace comprenant l'ancienne province du Vivarais (territoire historique de la Provence ancienne), le Velay et le Forez, les Alpes méridionales de part et d'autre de la frontière franco-italienne (vallée italo-occitanes) le Dauphiné et le nord de la Provence, ainsi qu'une poche en Calabre. Il est bordé au nord par le francoprovençal (ou « arpitan ») et à l'est par le piémontais. Son rattachement au provençal est, selon certains chercheurs, plus culturel que linguistique (contrairement au niçois, linguistiquement proche du maritime mais culturellement distinct) et relève de la sociolinguistique, même si les intenses échanges entre Haute et Basse Provence ont, comme Victor Gelu l'a décrit, mutuellement influencés et rapprochés les deux variétés de provençal. La zone autour de Digne-les-Bains constitue un espace de transition entre le sous-dialecte maritime et le vivaro-alpin.
Le vivaro-alpin présente d’importantes variations linguistiques internes pouvant amener à questionner la pertinence de son existence, même si, comme le note Philippe Martel, ces variations « sont surestimées » voire caricaturées par les locuteurs (qui ont perdu une pratique régulière qui fluidifiait de facto l’intercompréhension)[36].
- Ce dialecte se singularise entr'autre par son caractère conservateur : maintien de la prononciation des « -r » finaux des infinitifs, des « -l » finaux en [l] (ils sont parfois prononcés [ɾ]), de la prononciation sans amuïssement des « -a » finaux en [a] (sauf à l'ouest de la vallée de la Vésubie où on prononce [ɔ] comme en maritime et en rhodanien).
- Sa caractéristique principale est la chute des dentales intervocaliques latines simples (« d » et « t ») : chantaa ou chantaia pour chantada (forme standard en graphie classique) « chantée » ; monea pour moneda « monnaie » ; bastia ou bastiá pour bastida « bâtie » ; maür pour madur « mûr » ; crua pour cruda « crue » ; civaya pour civata « avoine » ect. Les « -t » finaux des participes passés masculins sont amuïs comme dans le reste des dialectes provençaux : chantà pour chanta (graphie mistralienne) / chanta (graphie classique) « chanté ».
- Le vivaro-alpin partage avec le limousin et l'auvergnat (autres variétés nord-occitanes) la palatalisation des phonèmes [k] et [g] devant « a » : [t͡ʃ] chantar « chanter » et [d͡ʒ] jauta « joue » contre canta / cantar et gauto / gauta. Cette palatalisation dans la toponymie permet de mesurer le recul du vivaro-alpin par rapport au provençal, par exemple à Orange (Aurenga > Aurenja).
- La désinence verbale de la première personne du singulier est « o » (comme en francoprovençal et en piémontais) : parlo « je parle » au lieu de parle (rhodanien) / pàrli (maritime) ; parlavo « je parlais » à la place de parlave (rhodanien) / parlàvi (maritime) ; parlèro « j'ai parlé, je parlerai » contre parlère (rhodanien) / parlèri (maritime).
- Le passage de « l » à « r » (rhotacisme) est fréquent : barma pour balmo / balma (languedocien) « grotte » ; escòra pour escòla « école » ; saraa ou saraia pour salada « salade ». Ce trait est partagé par le dialecte maritime. Dans le val de Suse (Oulx, Bardonèche…), le « r » rhotarique, roulé, se différencie du « r » guttural à la française. La norme de l'école du Pô adaptée à ces parlers respecte cette distinction en notant « ŗ » ou « ř » le phonème [ʁ].
- Les « -m » finaux sont prononcés [m] à l'est et [n] à l'ouest.
Provençal écrit
En l'absence d'un pouvoir politique propre à la Provence, ou à l'équivalent d'une institution de normalisation comme l'Académie française, aucun système d'écriture n'est unanimement approuvé et adopté. Néanmoins, depuis le xxe siècle, la graphie mistralienne et la graphie classique sont les deux normes les plus couramment employées, même si les écritures « patoisantes » n'ont jamais cessé d'être utilisées. Bien que l'usage de la graphie classique croisse, la norme mistralienne domine toujours l'espace provençal du fait de facteurs traditionnels et culturels. Des controverses complexes existent entre les partisans des deux normes sur le statut du provençal — simple dialecte de l'occitan ou langue à part entière ? — ; l'utilisation d'une graphie particulière n'est pas toujours l'indice d'une prise de position dans le débat et, malgré ces oppositions, on dénombre aussi des actions unitaires[37]. Les partisans d'une langue polynomique existent[38], tout comme ceux qui souhaiteraient la mise en place de standards régionaux.
On recense des auteurs favorables à la stabilité de la norme et d'autres en rupture avec elle. Ces derniers se montrent ouverts aux usages flottants, aux localismes, et à davantage de phonétisation pour éviter certaines règles trop complexes de la graphie classique.
Koinê des troubadours
Graphies de la Renaissance
Les auteurs de la Renaissance utilisaient la lettre « y » pour plus facilement faire ressortir les diphtongues (« rey » au lieu de « rei »).
Graphies phonétisantes
Les graphies « phonétisantes » ou « oralisantes » parfois dénommées péjorativement « patoisantes » sont des codes écrits pensés pour rendre le plus fidèlement possible à l'écrit les réalisations orales et la variété dialectale[39]. Elles sont apparues au cours du xvie siècle, non sans critiques[alpha 13], lorsque les usages scripturaux médiévaux se sont perdus, et, même si elles ont été abondamment utilisées entre les xvie siècle et xxe siècle, elles sont en train de disparaître à cause de la raréfaction des locuteurs natifs[39]. En effet, ces graphies reposent sur un pacte entre l'auteur et le lecteur : le second doit maîtriser le parler du premier sinon, il ne pourra en déchiffrer le code écrit[alpha 14],[alpha 15]. En Provence, elles sont bâties à partir d'emprunts soit à la norme française soit à l'italienne, car ce sont les deux langues d'alphabétisation des provençaux[39]. On peut citer Victor Gelu et Gustave Bénédit parmi les auteurs employant ce type d'écriture.
Graphies italianisantes du Comté de Nice
Le niçois s'est écrit au moyen d'orthographes dites « italianisantes », car inspirées par les codes italiens, entre le xviie siècle et le milieu du XXe siècle, mais elles ont été peu à peu abandonnées à la suite de l'annexion du Comté de Nice à l'Empire français. Elles empruntaient notamment le graphème « gli » pour noter le son [ʎ] (« igli » chez Joseph Micèu qui le réduit à « gl » en fin de mot ; Joseph-Rosalinde Rancher, influencé par le français, emploie « il » en position finale)[40], « c » (devant « e » et « i ») et « ci » (devant « a », « o » et « u ») plutôt que « ch » pour transcrire le son [t͡ʃ] (« ch » se prononce [k] comme en italien), « gh » pour obtenir le son [g] devant « e » et « i » (à la place du traditionnel graphème « gu »), « gi » devant « a », « o » et « u » pour maintenir la prononciation [d͡ʒ] (au lieu de « j »), la lettre « ç » n'est pas employée.
Graphie des trouvères marseillais
La graphie dite des « trouvères marseillais provient des traditions d'écriture des XVIIe et XVIIIe siècles et des choix effectués par le lexicographe Claude-François Achard dans son Dictionnaire de la Provence en 1784. Il s'agit d'une graphie grammaticale et étymologique. En effet, il orthographie des mots selon leur racine (par exemple natien « nation » d'après le latin natio), retranscrit les consonnes finales muettes (bec « bec » [be], nuech « nuit » [nɥe], prim « mince, fluet » [priⁿ]), il note, alors qu'ils ne sont plus prononcés dans la région marseillaise, les « -r » des infinitifs, les « -s » du pluriel et les « -t » des participes et des adjectifs masculins. S'il réinstaure l'usage du graphème « lh » médiéval (bien que le son [ʎ] se soit réduit à [j] en provençal), il emprunte certaines conventions orthographiques françaises : « ou » pour le son [u], (souleou) « gn » pour [ɲ], « o » pour les voyelles finales atones provenant du a latin prononcées [ɔ][41].
L'appellation « trouvères marseillais évoque des auteurs écrivant selon des normes indépendantes mais ayant en commun de noter des consonnes muettes étymologiques : Pierre Bellot, Marius Decard, Étienne Garcin, Félix Peise et Jean-François Roux notent tous les « -r » infinitifs et les « -s » pluriels[D 2]. Bellot et Decard notent aussi les « -t » des participes passés, les prétérits « -et », remplacent le graphème « ll » par le médiéval de « lh » ; si le marseillais rétablit aussi les « ch » finaux, l'aixois va plus loin en restaurant la terminaison « -m » de la première personne du pluriel, les « -ment » des adverbes, les « -r » finaux nécessaires pour expliquer la formation des dérivés. Decart différencie la conjugaison de la deuxième personne du pluriel de celle de la deuxième personne du singulier en la notant « az ». Étienne Garcin conserve quant à lui le « t » latin de la troisième personne du pluriel[D 3]. Ces auteurs ont concentré leur réflexion sur l'aspect consonantique du provençal et ont continué d'utiliser un système vocalique inspiré par le français[D 2].
Graphie de Simon-Jude Honnorat

Simon-Jude Honnorat reste proche de la graphie des trouvères marseillais mais s'en détache en restaurant le graphème « -a » pour les voyelles issues du a latin post-tonique[41] et en employant le digramme « ge » pour noter le son [d͡ʒ] devant les lettres « a », « o » et « u » sans changer le radical (mangear « manger » qu'il indique se prononcer mandjà[C 1],[42]) dans une démarche similaire au « gi » italien (mangiare [man.ˈd͡ʒa.re]) et au « ge » français pour le son [ʒ] (« mangeons » [mɑ̃.ʒɔ̃]).
Damase Arbaud rétabli quant à lui le « -tz » de la deuxième personne du pluriel (pourtant réduit à [s] ou même par endroit totalement amuï) et le « -m » de la première personne du pluriel[41].
Norme mistralienne

La norme mistralienne, ou « norme moderne », s'appuie sur une orthographe « simplifiée » — qualifiée de « phonétique » par ses détracteurs — pour limiter les distorsions entre l'écrit et l'oral. Elle a été mise au point par Joseph Roumanille et promue avec modifications par Frédéric Mistral au cours des années 1850. Le Félibrige l'emploie depuis sa fondation en 1854 tout comme d'autres mouvements plus récents tel que Parlaren ainsi qu'une grande partie des écrivains, chanteurs, enseignants et institutions locales. On assimile souvent la norme mistralienne à une transcription du rhodanien mais les travaux de Pierre Vouland[43] ont montré de nombreuses différences morphophonologiques entre le rhodanien parlé et le provençal écrit. Depuis 2006, un Conseil de l'Écrit Mistralien (Consèu de l'Escri Mistralen abrégé en « CEM »), organe interne du Félibrige, a été créé à l'initiative du majoral Bernard Giély avec pour mission de compléter l'œuvre lexicographique de Mistral[44].
Tout d'abord partisan du système graphique d'Honnorat, Mistral, sous la pression de Roumanille[13], finit par opter pour l'écriture dite « mistralienne » afin de faciliter l'apprentissage écrit du provençal aux habitants du Midi. Si la norme mistralienne suit quelques usages français comme employer le graphème « gn » pour retranscrire le son [ɲ] ou utiliser « ou » pour noter le son [u] — mis à part dans les diphtongues où Mistral rétablit l'usage médiéval d'écrire « u » — elle n'en est néanmoins pas un calque.
Dans le but de faire coïncider écrit et oral, les marqueurs grammaticaux tel que les « -r » infinitifs (maintenus dans un premier temps avec un tiret sous la forme « -r »[D 1],[alpha 16]) les « -s » pluriels et les « -t » des participes passés devenus muets en provençal sont supprimés (mais conservés et notés dans les dialectes où ils sont toujours prononcés comme le languedocien), aucune forme de mot n'est arbitrairement privilégiée ni élevée au rang de standard (fueio, fiueio, fuio sont ainsi tous recevables pour dire « feuille »), « t » n'exprime plus la valeur [s] comme chez les « trouvères marseillais » et est remplacé par « c » (natien chez Achard contre nacioun / nacien chez les félibres). Contrairement aux idées reçues, la norme mistralienne n'est pas phonétique : ainsi, « n » est muet dans inmourtau (immortel) et annecioun (annexion) ne se prononce pas [aⁿnesiun] ni [annesiun] mais [anesiun] ; dans ces deux exemples, les félibres recourent à une notation étymologique pour rendre compte de la greffe des préfixes latins « ad- » (devenu « an- » par assimilation régressive) et « in- » ; nous avons donc ad + nexus pour le premier et in + mortalis pour le second. Toutes les consonnes finales écrites ne se prononcent pas, c'est le cas de « b », « d », « p » et « t »[26] même s'il existe quelques exceptions[alpha 17]; quand un mot se termine par deux consonnes, la seconde est toujours muette[26] (mars se dit par exemple [maʁ] ou [maɾ]) ainsi « t » est muet dans les participes présents (« -ant », « -ent », « -int ») et quand il n'est noté que par souci d'étymologie, de dérivation ou parce qu'il s'entend en liaison (tant s'écrit ainsi car il provient du latin tantum ; gènt du latin gentem ; enfant du latin infantem, mais également à cause de ses dérivés enfanta « enfanter », enfantamen « enfantement » ; idem pour argènt qui se dérive en argentarié « argenterie », argentié « argentier, orfèvre », argentiero « mine d'argent » et qui est issu du latin argentum ect.)[26] ; sont également muettes toutes consonnes finales immédiatement précédées par une diphtongue ou une triphtongue[26] (exemple : biais et pèis) ; « s » dans pas est muet lorsqu'il exprime la négation mais prononcé quand il fait référence à la « paix » ou au « pas qu'on fait en marchant » (quoiqu'un peu moins fortement[26]). La lettre « e » vaut [e] mais également [ɛ] lorsqu'elle précède un « l » (bello [bɛlɔ] « belle »), un « r » géminé (terro [tɛʁɔ] « terre ») ou un groupe de consonne dont la première est un « r » (serp [sɛʁ] ou [sɛɾ] « serpent », verd [vɛʁ] ou [vɛɾ] « vert »)[26]. En conjugaison, la terminaison de la troisième personne du pluriel « -on » ne se prononce pas [ɔⁿ] ou [ɔn] mais [u] (en rhodanien) ou [uⁿ] (en maritime) ; c'est une astuce de Mistral pour distinguer les « oun » atones. À l'inverse de la norme classique, les accents toniques irréguliers sont notés en graphie mistralienne via un accent grave sauf pour la lettre « e » qui prend un accent aigu car le graphème « è » exprime le son [ɛ]. La norme mistralienne amorce un début de trans-dialectalisme car le graphème « ch » retranscrit aussi bien [t͡s] (rhodanien) que [t͡ʃ] (maritime) et « j » / « g » (devant « e » et « i ») [d͡z] (rhodanien) que [d͡ʒ] (maritime), « ue » se prononce [ɥe] en maritime et [ø] en rhodanien (Mistral prononce donc niue [njø] « nuit »). Le graphème médiéval « lh » existe mais est inutilisé en provençal où « h » et « i » le remplacent. La graphie mistralienne a inventé les graphèmes « òu » [ɔw] et « óu » [ow][45],[46].
Avec l'élaboration de la graphie mistralienne, Joseph Roumanille exprime son rejet d'une écriture traditionnelle qu'il estime dépassée au profit d'une écriture plus proche de l'oral qui sera basée en partie sur la phonétique française (encourpouracioun par exemple serait un gallicisme d'incorporacion car le « in » ancien est devenu « en » en provençal mistralien puisque c'est sa prononciation française). C'est en partie à cause des choix orthographiques de Roumanille que certains partisans de l'écriture classique décidèrent de faire sécession du Félibrige pour fonder la Société d'Études Occitanes (SEO) où ils développeront la norme classique en se basant sur les recherches de Simon-Jude Honnorat et sur le dictionnaire de Frédéric Mistral pour adapter l'écriture ancienne aux évolutions du temps, tout en réaffirmant l'unité de la langue et en choisissant une plus grande oralisation des dialectes même si les distinctions écrites sont toujours présentent et parfois-même amplifiées par des usages populaires souhaitant faire un mélange avec l'écriture mistralienne. L'adoption populaire de l'écriture de Roumanille ne s'est pas faite sans heurts, sans débats préalables ou critiques houleuses[47],[D 2].
Norme classique
La norme classique a été codifiée en 1935 par Louis Alibert dans son ouvrage Gramatica occitana segon los parlars lengadocians et s'inscrit dans la continuité des travaux du docteur Honnorat. Elle s'appuie sur les réformes initiées à la fin du xixe siècle par le majoral limousin Joseph Roux, les instituteurs languedociens Antonin Perbosc et Prosper Estieu, le travail de normalisation de Pompeu Fabra pour le catalan[alpha 18], tout en tenant compte de certaines innovations de la norme mistralienne dont elle se veut la réforme[14]. La norme classique a été améliorée à la suite de la parution en 1943 de la « Grammaire occitane » du majoral Joseph Salvat qui remettait partiellement en cause les choix graphiques d'Alibert (notamment les accents) ; les propositions de Salvat seront pour l’essentiel reprises après guerre par l'Institut d'études occitanes (l'héritier de la Société d'études occitanes) dans son livret « La réforme linguistique occitane et l'enseignement de la langue d'Oc ». À partir des années 1950 et jusqu'à la fin du xxe siècle, la norme classique a été adaptée pour écrire les dialectes provençaux, nord-occitan, cisalpin et aranais.
Norme de l'École du Pô
La norme de l'école du Pô est une graphie cisalpine élaborée par des poètes et des linguistes pour représenter les spécificités du vivaro-alpin des Vallées occitanes italiennes. Le graphème « eu » ne note pas [ew] mais [ø] comme en français, en lombard, en génois et en piémontais, « ë » représente le son [ə], « ç » le son [θ] et « x » le son [ð], les digrammes « dz », « sh » et « zh » valent respectivement [d͡z], [ʃ] et [ʒ], « ii » note une succession de semi-voyelles, l'accent circonflexe indique une voyelle longue (ëncoû « encore »), la lettre « n » est doublée pour marquer une différence entre une consonne finale nasalisée (an « ils ont ») et une consonne finale apicale (ann « année »). Les graphèmes « lh » et « nh » sont maintenus.
Graphies intermédiaires
La graphie classique de base est une version simplifiée de la graphie classique élaborée par un groupe de travail qui se réunissait au Centre culturel de Cucuron dans les années 1970[41]. Elle propose d'abandonner « -tz » au profit de « -s » en position finale sauf pour la conjugaison de la deuxième personne du pluriel, de noter conformément à la prononciation « -ié » plutôt que « -iá » à l'imparfait et pour les substantifs féminins concernés, de simplifier l'écriture des groupes consonantiques « tg » (viage et pas viatge « voyage »), « tj » (viajar à la place de viatjar « voiturer, voyager »), « tl » (espala au lieu espatla « épaule ») et « tm » (semana contre setmana « semaine ») qui sont réalisés comme des consonnes simples en provençal. Cette graphie n'est pas très employée en dehors de contributions sporadiques dans le mensuel « Aquò d’Aquí »[D 4] bien qu'un recueil de textes ait été publié en 1982[48] dans cette graphie tout comme un « Manuel pratique de provençal contemporain »[49].
Au début des années 1980, une graphie mélangeant le système consonantique de la norme classique et le système vocalique de la norme mistralienne a été proposé par le professeur Jean-Claude Bouvier. L'association « Dralhos Novos : per l'unitat grafico » utilise cette orthographe depuis 1999[41].
Comparaisons entre les normes mistralienne et classique
Le provençal connaît depuis le XXe siècle deux systèmes d'écriture concurrents qui diffèrent par l'orthographe et, parfois, par les formes orales qu'ils induisent. Pour cette raison, on parle souvent de deux graphies différentes même s'il serait plus exact de parler de normes car incluant chacune une orthographe et des formes orales.
Orthographe identique, forme orale identique
Les termes en ancien provençal montrent la diversité d'écriture des mots pour l'ensemble des dialectes occitans.
| Ancien provençal | Prononciation moyenâgeuse | Graphie mistralienne | Graphie classique | Prononciation moderne | Traduction en français |
|---|---|---|---|---|---|
| sel ; cel | [ˈsel] ; [ˈt͡sel][50] ou [ˈseɫ] ; [ˈt͡seɫ] | cèu | cèu | [ˈsɛw] | ciel |
| gran | [ˈgran] | grand | grand | [ˈgʀaⁿ] | grand |
| natural ; naturau | [natural] ou [naturaɫ] ; [naturau] | naturau | naturau | [natyʀaw], [natyɾaw] | naturel |
Orthographes différentes, forme orale identique
Le passage d'une norme à l'autre peut entrainer des changements orthographiques sans généralement altérer la forme orale. Certains dérivés sous-dialectaux ne sont toutefois pas pris en compte par la graphie classique dans un souci de standardisation des dialectes. Ainsi, le mot varois fiuelho ([fueljɔ]) de l'ancien provençal fuelha (prononcé [fueʎa] ou [fuelja]) est abandonné au profit de la forme fuelha prononcé [fɥejɔ] jugée plus commune et plus évoluée.
Les sigles proviennent du dictionnaire de Frédéric Mistral ont les significations suivantes :
- alp. = alpin ;
- mar. = maritime standard ou/et marseillais ;
- mar-ori. = maritime oriental (arrondissement de Grasse) ;
- niç. = niçois ;
- rho. = rhodanien ;
- var. = varois (Var + arrondissement de Grasse).
Les termes en ancien provençal montrent la diversité d'écriture des mots pour l'ensemble des dialectes occitans.
| Français | Ancien provençal | Graphie mistralienne | Graphie classique | prononciation (API) |
|---|---|---|---|---|
| avril | april, abriel, abriu | abriéu | abriu | [aˈbʀiw, aˈbʀjew] |
| boire | beber, beure | béure, buoure (mar.) | beure | [ˈbewre] |
| eau | aiga, aigua, ayga, aygua | aigo, aiga (niç.) | aiga | [ˈajgɔ], [ˈajga] |
| femme | frema, fembra, femena, frema, fempna, femna, fenna, femma, fema | femo/fumo (rho.), fremo/frumo (mar.), frema/fruma (niç.) | femna (rho.), frema (mar., niç.) | [ˈfeⁿnɔ, ˈfemɔ, ˈfɾemɔ] |
| feu | fuc, foec, fuec, fog, foc, fuoc, fioc | fiò (rho.), fue (mar.), fuec (mar-ori.), fuoc (niç.), fiue/fiuec/fuéu/fuou (var.) | fuòc, fuec (mar.) | [ˈfjɔ] [ˈfɥe] |
| honneur | haunoo, honnor, honor, onor | ounour | onor | [uˈnuʀ] |
| hommes (pl.) | om, hom, ombre, omne, homi, home | ome | òmes | [ɔme] |
| jour | jort, jorn, jor | jour (rho., niç., mar-ori.), jou (mar., niç.), journ (alp.) | jorn | [ˈdʒuʀ, ˈdzuʀ] |
| ligne | linha | ligno, ligna (niç.), lino (mar.) | linha | [ˈliɲɔ], [ˈliɲa] |
| manger | minhar, minyar, mingar, menyar, menjar, mengar, mandugar, mangar, maniar, manjar | manja, menja (alp.) | manjar | [maⁿˈdʒa] |
| Mireille | - | Mirèio, Mirèia (niç.) | Mirèlha | [miˈrɛjɔ], [miˈrɛja] |
| Nice | Niza, Nisa, Nissa | Niço, Niça/Nissa (niç.) | Niça | [ˈnisɔ (ˈnisa)] |
| occitan | - | óucitan | occitan | [u(w)siˈtaⁿ] |
| Occitanie | - | Óucitanìo, Óucitanié (mar.) | Occitània, Occitaniá (mar.) | [u(w)siˈtanj], [u(w)siˈtanie] |
| petit | - | pichoun, pechoun (alp.), pichot (rho.) | pichon, pichòt | [piˈtʃuⁿ] |
| Provence | Prozensa, Prohenssa, Prohensa, Proenza, Proensa | Prouvènço, Prouvènça (niç.) | Provença | [pʀuˈvɛⁿsɔ] |
| provençal | Proensal, Proensau | prouvençau | provençau | [pʀuveⁿsˈaw] |
| terre | Terra | terro, tearro (alp.), terra (niç.) | tèrra | [ˈtɛʀɔ], [ˈtɛʀa] |
| taille | tala, tailha | taio | talha | [ˈtajɔ], [ˈtaja] |
| proximité | propinquitat | proussimeta, proussimita (mar., niç.) | proximitat | [prusimita] |
| étoile | estela, stella, estella | estello (mar.), estela (niç.), estelo (rho.), estielo/estiero/estialo/esteero/estearo (alp.) | estèla, estela (niç., rho., alp.), estiela/estrela (alp.) | [ɛstɛlɔ], [ɛstela], [ɛstelɔ], [ɛstielɔ] |
| étoilé | estelat | estela, esteara (alp.) | estelat | [ɛstela] |
| forêt | silva > selva > salva > sauva | séuvo, séuva (niç.) | seuva | [sewvɔ] |
Le changement du -ou vers le -o s'explique par l'utilisation du -o d'origine qui se prononçait dans un son proche du -ou est qui finit par le devenir avec la francisation de l'écriture du provençal[51]. De même pour le -a final qui est muet devant une voyelle et après un -i, et presque muet devant une consonne, s'est écrit au fil des siècles par un -a (maintenu à Nice) puis par un -e (temporairement à Marseille) avant de redevenir un -o (normalisation de l'écriture mistralienne mais accepte les écritures avec -a et -e)[11].
La diphtongue -iéu (jew) en écriture mistralienne a été déclarée standard par le Felibrige vis-à-vis de l'écriture traditionnelle -iu donnant le son (iw). On retrouve la prononciation et l'utilisation du -iéu principalement dans les Bouches-du-Rhône entre Arles et Marseille alors que le reste de la Provence conserve encore l'écriture -iu. En français, les termes de riéu et riu donnent respectivement rieu et riou (exemple : nom d'un quartier de Cannes). L'écriture classique choisit de standardiser -iu et d'oraliser le son -jew.
Le choix du -e est là encore une francisation car comme l'explique Simon-Jude Honnorat dans son dictionnaire, "Mountagna" se prononce "Mountagne". Les rhodaniens de Roumanille, en voulant imposer à la Provence la norme d'écriture du Rhône, auquel était opposé, à ses débuts, Mistral qui voulait choisir celle d'Honnorat[52], ont remis à l'ordre du jour le -o à la place du -e. En réalité, le -o final peut-être remplacé par un -a, tout comme Mistral expliquait que le -a niçois pouvait s'écrire comme le -o provençal car la prononciation était similaire[B 2]. Le -a final ne se prononce plus comme le -a d'origine mais produit un son -a bref et presque muet qui ressemble au -o de "sort", "pomme". Devant une voyelle ce -a/-o ne se prononce pas.
Les digrammes -lh et -nh sont présents dans l'ancien provençal au côté d'autre solution graphique comme -gn, -yn, -n, -in, -nn, -ing, -ign, -ingn, etc. pour le son [ɲ]. puis ont été abandonnées par francisation et italianisation au profit du -gn et du -ll/-i/-lh. En revanche, au Moyen Âge, le -nh et le -lh du Midi se sont exportés dans d'autres langues comme le portugais[51]. Avant la réforme de Roumanille, les dialectes du marseillais (ancien nom du maritime) employait -ll qui fut remplacé par -i, c'est ainsi que l'on écrivait Marsillo devenu Marsiho, qui ne sont que des altérations du mot d'origine Marselha que certains écrivent Marsilha[53].
Dans l'écriture classique, la règle du -e est la plus savante de toutes car selon les lettres qui la suivent[54], elle se prononce -é (soleu), -i (Marselha), -u (frema), -a (mercat). Certains occitanistes pour éviter d'avoir recours à cette règle tendent à ne pas oraliser la prononciation dialectale mais à l'écrire selon les préconisations de Roumanille mélangée à l'écriture classique et ainsi écrire : soleu, Marsilha, fruma, marcat. Cependant, ces modifications populaires varient suivant l'usage de chacun mais tendent à se conformer aux simplifications apportées par l'écriture mistralienne.
Les occitanistes surutilisent le -ç en l'incorporant à l'initiale et à la finale des mots, c'est ainsi que Laurens devient Laurenç ou encore Mars devient Març (mois), mais se conserve pour dimars (mardi) et Mars/Marts (Dieu). Les occitanistes n'utilisent pas tous le choix du -ç, tout comme certains ne remettent pas tous les -ts et tz finaux qui se prononcent -s[53]. D'autres choisissent de supprimer la lettre -ç et reviennent au -s, c'était le cas des classicistes provençaux qui ont pendant un temps écrit "Provensa" selon la forme médiévale[55] avant de repasser à "ç" (exemple d'évolution du mot Provence: Provincium > Provensa > Provenço > Provença).
On note aussi dans l'espace maritime que certaines personnes choisissent d'écrire -ien au lieu de -ion (normalisation de l'écriture classique qui peut aussi se prononcer -ian localement)[54] car on écrit et on prononce traditionnellement -ien ce sous-dialecte à l'exception de l'arrondissement de Grasse qui conserve comme les sous-dialectes niçois et rhodanien la prononciation -ioun qui s'écrit -ion/ioun selon les graphies.
En finalité, l'objet de la graphie classique vise à une plus grande unité de l'écriture de la langue d'oc par l'oralisation de ses dialectes et de ses sous-dialectes, ce qui est l'exact inverse de la graphie mistralienne. Ceci engendre par la même occasion une plus grande unité dans l'écriture des sous-dialectes provençaux. En effet, là où l'écriture mistralienne propose pour le mot français "jour" les formes "jour" (générale), "jou" (marseillaise) et "journ" (alpine), l'écriture classique propose le mot en ancien provençal "jorn" qui s'oralise en (jour, journ, jou) selon les localités en Provence. En parallèle, on a la même situation en langue française où le mot "moins" se prononce par endroit "mouin" et "mouince".
Orthographes différentes, formes orales différentes
Il existe quelques différences de prononciation entre les normes mistraliennes et classiques car la dernière souhaite lutter contre certains francismes récents en modifiant superficiellement certains mots pour les calquer sur les mots anciens ou simplement en incorporent des mots anciens qui n'étaient plus usités du fait de l'influence du français. Ceci avec pour objectif de rendre un aspect plus authentique à la langue.
| français | En graphie mistralienne, prononciation (API) | En graphie classique, prononciation (API) |
|---|---|---|
| août | avoust [aˈvus] | avost [aˈvus] ou aost[56] [aˈus] |
| janvier | janvié [dʒaⁿˈvie] | genier [dʒeˈnje] (aussi "genoier" et "janvier" (francisme)) |
| juillet | juliet [dʒyˈlje] ; alpine: juiet [dʒyˈje] | julhet [dʒyˈje] |
| machine | machino (francisme) [maˈtʃinɔ] | maquina [maˈkinɔ] |
| particulier | particulié (francisme) [paʀtikyˈlje] | particular [paʀtikyˈlaʀ] |
| service | service (francisme) [seʀˈvise] | servici [seʀˈvisi] |
| téléphone | telefone (francisme) [teleˈfɔne] | telefòn [teleˈfɔⁿ] |
Provençal littéraire
Littérature
Théâtre
Opéras baroques
Dictionnaires et ouvrages de grammaire
Statut légal


Entre reconnaissance et substitution

L'usage du provençal est vécu par une partie des provençaux comme un élément de leur héritage patrimonial ; il jouit d’un certain soutien de la population et des collectivités locales et bénéficie depuis les années 80 d’un regain de visibilité dans la vie publique à travers la publicité[57],[58], la signalisation routière[58],[59], les édifices[58], les festivals[alpha 19] et le théâtre, etc. Cette reconnaissance reste cependant symbolique et ne s'accompagne en général pas de mesures visant à développer ou revitaliser le provençal.
Le recul de l'usage du provençal est ancien. Il a cédé depuis longtemps les fonctions courantes de communication au français (diglossie limitée).
Le provençal est reconnu « sérieusement en danger » par l’Atlas des langues en péril édité par l’UNESCO[60]. Les raisons de son déclin sont complexes. Pour la partie provençale qui a été rattachée à la France en 1483, on accuse souvent l'action centralisatrice des rois de France qui a écarté le provençal des actes juridiques (progression du français dans les élites sociales dès le XVe siècle, puis l'Ordonnance de Villers-Cotterêts du instituant le français comme la langue des documents administratifs). Cela n'est pas possible pour le pays niçois, le Comtat Venaissin ou Avignon qui n'étaient pas français alors. Au XIXe siècle, l'école royale, impériale puis républicaine n'a jamais donné au provençal un statut spécifique dans l'enseignement. Le provençal a été marginalisé dans les médias importants.
Depuis les années 2000, il existe en Provence[61] une association — Collectif Provence — pour qui le provençal est « une langue à part entière, proche mais distincte de l'occitan du Sud-Ouest de la France »[62], sans toutefois rejeter son appartenance à l'ensemble des langues d’oc[63],[64]. Ce mouvement souhaite imposer l'usage exclusif de la norme mistralienne et opérer un sécessionnisme linguistique en faisant du provençal une langue à part entière[65],[66],[67] afin de contrer la dynamique orchestrée par les classicistes languedociens qui tend à se développer partout dans le Midi depuis des décennies notamment en Provence, où on retrouve plusieurs auteurs classiques en dialecte provençal comme Robert Lafont.[non neutre] À l'inverse de cette association culturelle tout aussi politiquement marquée que ses opposants[63]Interprétation abusive ?, le Felibrige — société savante fondée par Frédéric Mistral, Joseph Roumanille, Théodore Aubanel, Jean Brunet, Paul Giéra, Anselme Mathieu et Alphonse Tavan le 21 mai 1854 — propose la définition suivante qui fut adoptée lors du Conseil Général de la Santo-Estello (Sainte-Estelle) de Grasse en 1999 : « Le Félibrige retient comme seule terminologie pour être employée et défendue : la langue d’oc dans la diversité de ses parlers (Auvergnat, Gascon, Languedocien, Limousin, Provençal »[68].
En 2003, à la suite de l'action des uns et des autres, le Conseil régional de PACA a émis successivement deux vœux :
- le 17 octobre : « La langue provençale et la langue niçoise sont les langues régionales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur »[69]
- le 5 décembre : « Le Conseil Régional de Provence-Alpes-Côtes d’Azur affirme solennellement que la langue occitane ou langue d’Oc est la langue régionale de la région Provence-Alpes-Côtes d’Azur : le provençal rhodanien, le provençal maritime, le niçard et l’alpin sont les formes régionales de la langue occitane ou langue d’Oc en Provence-Alpes-Côtes d’Azur ; que toutes les variétés de la langue occitane ou langue d’Oc sont d’égale valeur et appartiennent au même domaine linguistique ; que chacune de ses variétés est l’expression de la langue occitane ou langue d’Oc sur son aire géographique ; que la pleine dignité donnée ainsi à chaque variété de la langue occitane ou langue d’Oc atteste qu’il n’y a aucune hiérarchie entre ces variétés. S’engage : à développer son soutien à la préservation de ces variétés et à la promotion de la langue occitane ou langue d’Oc ; à contribuer, au côté de l’État, à la généralisation de l’offre d’enseignement de la langue occitane ou langue d’Oc en Région Provence-Alpes-Côtes d’Azur. Sollicite Monsieur le premier Ministre pour qu’il intervienne auprès de ministres, directions de l’État concernés pour que la langue occitane ou langue d’Oc soit reconnue officiellement comme patrimoine commun de tous les citoyens français sans distinction et d’aider à son développement en ratifiant la Charte européenne des langues minoritaires. »[70]
En 2016, le Conseil Régional de PACA émet une nouvelle résolution dont le préambule contient une phrase ambigüe, parlant à la fois de la langue d’oc et de langues : « Ainsi, sur l’ensemble du territoire régional se sont développées des langues qui ont su véhiculer jusqu’à nous les traditions et les spécificités culturelles de l’histoire de notre région et de ses divers territoires : le provençal, le gavot ou le nissard. Cette pluralité linguistique est la spécificité de notre région dans l’espace de la langue d’oc »[71].
Expressions et proverbes
Voici quelques expressions usuelles (graphie mistralienne / graphie classique):
- Bono annado, bèn granado e bèn acoumpagnado / Bòna annada, ben granada e ben acompanhada. En français : bonne année, bien prospère, et bien accompagnée (de santé).
- Se fai pas lou civié avans d'avé la lèbre. / Se fai pas lo civier avans d'aver la lèbre. En français, littéralement : On ne fait pas le civet avant d'avoir le lièvre. Soit l'équivalent du proverbe français : il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué (Jean de La Fontaine, livre 5, fable 20 L'ours et les 2 compagnons).
- Fa(i) de bèn a Bertrand te/ti lou rendra en cagan / Fa(i) de ben a Bertrand, te/ti lo rendrà en cagant. En français : fais du bien à quelqu'un, et il t'envoie promener. Assemblage de faire, bien, à, Bertrand, il, te, le, rendre, en et caguer. D’après "le Parler Marseillais", ce proverbe n’avait rien de vulgaire à l’origine car c’était, avant de faire tomber le " r " : "Faï dè ben a Bertrand, té lou rendi en cargant" (= en accablant).
- « Arles en France, Aix en Provence, Nice en barbarie[B 11]. Ce proverbe traduit la guerre civile de l'Union d'Aix qui opposa les pro-angevins (Arles, Marseille, le Rhône, Antibes, notamment) aux pro-napolitains (Aix, Toulon, Nice et la majeure partie de la Provence) et qui se traduit par l'acte de Dédition de Nice à la Savoie et l'amputation au Comté de Provence des anciens territoires féodaux de Nice et de son futur arrière pays.
Mots français d'origine occitane dont provençale
De nombreux mots d'origine provençale ont migré vers le français. Il est souvent difficile de savoir précisément quels sont ces termes car les philologues et leurs dictionnaires étymologiques emploient souvent le terme de provençal, en lui donnant le sens de langue d'oc, pour qualifier l'origine d'un mot. Le contact intense entre le provençal et le français (répandu en Provence entre 1880 et 1950) a produit un français particulier à la Provence, très célèbre (film de Pagnol par exemple) et parfois stéréotypé, de sa prononciation (l'accent provençal et marseillais) à son vocabulaire, sa grammaire et ses modalités d'interactions[72],[73]
Quelques exemples :
- balade et ballade : balado / balada (mot présent dans d'autres dialectes occitans ; danse)
- s'esclaffer : esclafa / esclafar (éclater)
- mascotte : mascoto / mascòta (sortilège)
- qu'es acò (mot présent dans d'autres dialectes occitans ; à l'orthographe fluctuante par méconnaissance de son origine : par exemple, kézaco) : Qu'es acò ? / Qu'es aquò ? (Qu'est-ce que c'est ?)
L'architecture :
- mas : mas / mas (ferme)
- bastide : bastido / bastida (exploitation agricole bourgeoise)
La géographie :
- cime : cimo / cima (a pour équivalent catalan : cim ; correspond au français "sommet")
Le domaine maritime :
- cale : calo / cala (crique)
- dorade : daurado / daurada, littéralement, la "dorée" (mot présent dans d'autres dialectes occitans)
- supion : supioun / sepion/supion (mot présent dans d'autres dialectes occitans ; petite seiche)
La nourriture et les ustensiles de cuisine :
- anchoiade : anchouiado / anchoiada
- bouillabaisse :bouiabaisso / bolhabaissa
- mesclun : mesclun / mesclum (d'après le verbe mesclar qui signifie mélanger)
- salade : salado / salada, "salée" (mot présent dans d'autres dialectes occitans)
- tapenade : tapenado / tapenada, de tapeno / tapena, signifiant "câpre".
- tian (terrine qui a donné son nom au plat de légumes passés au four) : tian

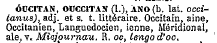
La faune et la flore méditerranéenne :
- abeille : abiho / abelha (mot occitan général)
- garrigue : garrigo / garriga plantation de chêne kermès (mot présent dans d'autres dialectes occitans ; appelé garric en provençal)
Les sentiments :
- amour : amour / amor, de l'ancien occitan Amor (prononcé "amour") - les équivalents des mots en -or en occitan (calor, flor, etc.) correspondent aux mots français en -eur (chaleur, fleur) et le mot "amour" aurait dû donner "ameur" en français.
Les sens de provençal, langue d'oc et d'occitan
Le sens du mot provençal est contingent à la période historique dans laquelle il est employé. Selon le contexte ou l'époque, il signifie langue d'oc ou l'idiome parlé en Provence. Ainsi, dans le premier cas l'auvergnat ou le limousin sont du provençal mais pas dans le second.
Le terme proensales est utilisé au XIIIe siècle par les écrivains italiens désignant la langue parlée dans la moitié sud de la France, faisant référence aux provinciæ romana de l'Empire romain qui désignait la Gaule méridionale. Frédéric Mistral dit d'ailleurs que "La lengo prouvençalo, la langue provençale, la langue du midi de la France et de la Catalogne, nommée aussi lengo d'O, langue d'Oc."[74]. D'autres appellations sont employées ensuite, le limousin par les catalans, la langue d'oc par Dante, le catalan par les savants du XVIIe siècle, ou celle très peu usitée de mondin inventée à Toulouse[75].
Au XIXe siècle les romanistes à la suite de Raynouard et jusqu'à Anglade, reprennent le terme provençal par généralisation pour, à la fois désigner l'occitan des troubadours en tant qu'« ancien provençal », et l'occitan moderne dans son ensemble. Mais ce terme introduisait une ambiguïté avec le parler de la Provence, l'occitan troubadouresque n’étant pas apparu en Provence, et ayant plus d’analogies avec le languedocien ou le limousin.
Le provençal est autant considéré par Frédéric Mistral comme un dialecte de la langue d'Oc (appelé aussi provençal) dans son dictionnaire Lou Tresor dóu Felibrige, qu'une langue (dans le sens où langue provençale équivaut à langue d'Oc moderne), comme en témoigne ses écrits dans «La lengo prouvençalo o lengo d'O»[31], «Lou parla dóu Rose, emé lou parla marsihés, formon ce qu'apelan pu particulieramen la lengo prouvençalo.» (Le parler du Rhône, avec le parler marseillais, forment ce que l'on appelle plus particulièrement la langue provençale) ou encore «La lengo prouvençalo se parlo encaro en Franço dins mai de vint despartamen: es que, se parlo pas pertout la memo causo» (La langue provençale se parle encore en France dans plus de vingt départements: elle ne se parle pas partout de la même façon). Ce qui n'est pas sans créer d’ambiguïté entre les termes de langue et de dialecte. Toutefois, l'auteur s'accorde généralement à dire dans l'ensemble de ses ouvrages qu'il existe une langue provençale ou langue d'Oc (ensemble du Midi de la France) et qu'elle est parlée depuis des siècles à travers ses dialectes. Il montre donc l'importance de préserver les distinctions dialectales. C'est par ailleurs cette forte atténuation des distinctions dialectales dans la graphie classique d'Alibert qui oppose ses partisans à ceux de la graphie mistralienne qui préserve davantage les variétés dialectales de la langue d'Oc.
Le mot provençal sert aussi, particulièrement jusqu’au milieu du XXe siècle[76], à désigner l’ensemble de la langue d’oc. C’est notamment le cas chez Frédéric Mistral[77] et dans les dictionnaires d’Honnorat, Dictionnaire provençal-français ou dictionnaire de la langue d’oc[78] et de Mistral, Le Trésor du Félibrige, dictionnaire provençal français embrassant les divers dialectes de la langue d’oc moderne ou les ouvrages de référence de Ronjat, Essai de syntaxe des parlers provençaux modernes[79] et Grammaire historique des parlers provençaux modernes[80]. Le mot reste utilisé dans le milieu romaniste pour désigner l’ensemble de l’occitan[81]. Cette synonymie est également affirmée par Emmanuel Le Roy Ladurie[82].
Lorsque Frédéric Mistral publie Lou Tresor dóu Felibrige, dictionnaire de la langue d'oc moderne en deux volumes, il comprend le terme provençal comme une acception du terme langue d'oc ; en sous-titre du dictionnaire, il précise : Dictionnaire provençal-français, embrassant les divers dialectes de la langue d'oc moderne, soit, comme il est mentionné dans la note 1, tous les mots usités dans le Midi de la France. Il y écrit qu'óucitan (qu'il traduit par occitain ou occitanien) est synonyme de «languedocien» ou de «méridional» et renvoie à «langue d'oc »[B 12].
Le mot occitan est basé sur celui d'Occitanie et Mistral dit que ce dernier renvoi à un "nom par lequel les lettrés désignent quelquefois le Midi de la France et en particulier le Languedoc". De même, il précise "le mot Occitania ou Patria Linguae Occitanae est la traduction usitée dans les actes latins du XIIIe siècle et XIVe siècle pour désigner la province du Languedoc."[83].
Actuellement, l'usage chez les linguistes est d'utiliser le mot provençal spécifiquement pour la variante parlée en Provence et la formule langue d'oc ou occitan pour parler de la langue dans son ensemble.
Notes et références
- Si l’on considère le vivaro-alpin comme un sous-dialecte provençal.
- Le code ISO 639-3 était
prvavant son retrait et sa fusion avecocien 2007. Le codeoci-prvest utilisé sur Endangered Languages Project (en). - Selon la classification de Jacques Allières
- L'appel au calme envoyé par Louis XVI après la Révolution Française de 1789 est envoyé en provençal et non en français sur le territoire provençal.
- Dès les années 1920, les pécheurs des petites villes côtières avaient pour habitude de s'interdire de parler provençal en arrivant sur le quai, à terre, et de l'interdire à leurs enfants, par déférence pour ceux qui ne comprendraient pas la langue jugée vulgaire (Blanchet).
- Le terme « parlers provençaux modernes » représente l'ensemble de la langue d'oc dans ses travaux.
- En aranais ues pour òs, en rouergat pouorto pour porto
- Le languedocien ne note pas la vocalisation du -s du pluriel en /j/, qui est pourtant fréquente : « lai beloi filjos ». L'aranais note les pluriels en -i : « es aranesi ».
- Aquo d'Aqui, magazine provençal d'expression classique et mistralienne, exemple d'utilisation populaire du -ien pour remplacer le -ion, https://www.aquodaqui.info/
- Cela se prononce [niˈsaʀt] ou [niˈsaʀte].
- La tendance populaire est de respecter la tradition et d'écrire « nissart » avec un double -s. Les mistraliens et les occitanistes promeuvent l'utilisation de -ç pour se rapprocher du nom antique de la cité : « Nicaea ».
- Voir le texte de Robert Lafont, Té tu, té iéu, https://www.cieldoc.com/libre/integral/libr0084.pdf
- Le linguiste Auguste Brun écrit en préface de Bellot dans Veillées provençal :
« Le joug des règles, ils le secouent ; l'orthographe, ils n'en ont pas soucis. Chacun agit à sa guise, écrit les mots comme il les prononce, et de là naissent l'arbitraire et la confusion… (au contraire) Bellot se garde bien de ne faire aucune différence entre l'infinitif et le participe, tandis que la plupart des auteurs qui se servent du provençal mêlent tout, brouillent tout, confondent tout et semblent n'avoir aucune idée des dérivés, de l'étymologie et de la syntaxe. Ils francisent le provençal et provençalisent le français. »
- Achard écrit à ce sujet, (Dictionnaire de la Provence et du Comtat Venaissin) :
« Tous les Auteurs modernes qui ont écrit en provençal se sont fait une orthographe arbitraire ; le plus grand nombre a écrit le Provençal comme on le parle. De là la confusion entre les Infinitifs et les Participes, et une variation constante dans certains mots qui rend la langue provençale très-difficile à lire, pour ceux qui n’en ont pas contracté l’habitude. Nous avons cru devoir établir une syntaxe provençale qui se rapprochant de l’ancienne, facilitera aux Provençaux la lecture des Écrivains en cette langue qui viendront après nous, ou qui nous ont précédés. »
- Le poète gascon, Jasmin, fait le constat suivant, (Mous noubèls souvenis) :
« Et qu'és acos ? escarraougnon ma lengo, Coumo s’abioy escribut d'aleman ! ! Y passon touts l'un aprèt l'aoutre et fan Un loun tchampiou de moun chan de mezengo...? (...) mais me cridon talèou, En me baillan lour journal flamben nèou... « ! Tè ! Legis ! aqués mots nous chagrinon. »(...)Sou muts daban nostro lengo escribudo ; La parlon touts, sâbon pas la legi ; Et qu’est cela ? Ils écorchent ma langue comme si j’avais écrit de l’allemand ! Ils y passent tous l’un après l’autre et font un brouhaha de mon chant de mésange ?...[…] Mais ils me crient aussitôt, en me donnant le journal flambant neuf : Tiens ! Tiens ! lis ! Ces mots nous chagrinent.[...] … Ils sont muets devant notre langue écrite. Ils la parlent tous, ils ne savent pas la lire. »
- En 1852, dans Li Prouvençalo, premier recueil de poésie des futurs félibres, on peut ainsi lire abena-r, abrasa-r.
- Par exemple, dans vènt et dubert, le « t » est sonore ; si l'on parle de la ville d'Aup le « p » est muet mais pas quand évoque les Alpes
- Par exemple en employant « -ç » comme lettre finale à la place de « -ts » en ancien provençal et en généralisant son usage à l'initial ou en milieu de mot.
- On peut par exemple citer le Festival de théâtre provençal de Fuveau dont les représentations se font exclusivement en provençal
- Enquête sur les langues régionales lors du recensement de 1999. Plus que 100 000 locuteurs de provençal ?
- Jean-Marie Klinkenberg, Des langues romanes. Introduction aux études de linguistique romane, De Boeck, 2e édition, 1999,
- La langue se divise en trois grandes aires dialectales : le nord-occitan (limousin, auvergnat, vivaro-alpin), l’occitan moyen, qui est le plus proche de la langue médiévale (languedocien et provençal au sens restreint), et le gascon (à l’ouest de la Garonne). in Encyclopédie Larousse
- (oc) Domergue Sumien, « Classificacion dei dialècles occitans », Linguistica occitana - VII, (lire en ligne)
- https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Nos-missions/Promouvoir-les-langues-de-France/Langues-regionales
- Jean-Claude Bouvier, « L'occitan en Provence. Le dialecte provençal, ses limites et ses variétés », Revue de Linguistique Romane, Lyon, vol. 43, no 169, , p. 46-62 (ISSN 0035-1458, lire en ligne)
- Marie-Jeanne Verny, « Enseigner l’occitan au XXIe siècle. Défis et enjeux », Tréma - revue internationale en sciences de l'éducation et didactique, Montpellier, Faculté d'Éducation de Montpellier, vol. 31 « L'enseignement des langues régionales en France aujourd'hui : état des lieux et perspectives », , p. 69-83 (ISSN 2107-0997, lire en ligne) :
« Il existe, çà et là, dans l’espace occitan, quelques velléités localistes, refusant de reconnaître l’unité de la langue d’oc, se référant à « des langues d’oc » [...]. Les tenants de ces positions sont cependant extrêmement minoritaires, en termes de reconnaissance populaire (même si leur influence est parfois sensible en Provence, Béarn ou Auvergne). L’immense majorité des universitaires, comme l’immense majorité des militants, y compris les tenants actuels de la graphie mistralienne, admet l’unité de la langue d’oc dans sa diversité dialectale. »
- On distingue plusieurs aires dialectales au sein même de l’occitan. […] À l’est du gascon et au sud du nord-occitan, une troisième aire, l’occitan moyen, comprend le languedocien, le provençal et le niçard (Nice). Le provençal se particularise notamment par des traits grammaticaux résultant de la disparition des consonnes finales. in Encarta « Copie archivée » (version du 3 octobre 2009 sur l'Internet Archive)
- Alfred Jeanroy, Histoire sommaire de la poésie occitane, des origines à la fin du XVIIIe siècle, (réimpr. 1973) (lire en ligne)
- Joseph Salvat, « Provençal ou occitan ? », Annales du Midi, vol. 66, no 27, , p. 229–241 (DOI 10.3406/anami.1954.5998, lire en ligne, consulté le )
- Philippe Blanchet, Le provençal : essai de description sociolinguistique et différentielle, Peeters, (ISBN 90-6831-428-9 et 978-90-6831-428-1, OCLC 29377832, lire en ligne)
- Gérard Bodé, « L'imposition de la langue (1789-1815). », Revue du Nord, vol. 78, no 317, , p. 771–780 (DOI 10.3406/rnord.1996.5155, lire en ligne, consulté le )
- Frédéric Mistral et Joseph Roumanille, Correspondance entre Mistral et Roumanille, Raphèle-les-Arles, (lire en ligne)
- (oc) Louis Alibert, Gramatica occitana segon los parlars lengadocians, Barcelone, Casa de caritat, 1935-1937 :
« Estimam qu'al punt de vista de la grafia, cal conciliar nòstras tradicions classicas, los resultats de l'estudi scientific de la lenga, la grafia mistralenca e la grafia catalana (Nous estimons que du point de vue de la graphie, il nous faut concilier les traditions classiques, les résultats de l'étude scientifique de la langue, la graphie mistralienne et la graphie catalane). »
- Daphnée Pagni. « Le déclin des langues régionales en France: le provençal, une langue vouée à disparaître ? »
- Moseley, Christopher (ed.). 2010. "langues de France", Atlas interactif UNESCO des langues en danger dans le monde, 3e édition, en ligne.
- James Costa et Médéric Gasquet-Cyrus, « Introduction », Lengas. Revue de sociolinguistique, no 72, , p. 9–21 (ISSN 0153-0313, DOI 10.4000/lengas.109, lire en ligne, consulté le )
- Guy Martin, Bernard Moulin, Grammaire provençale (écriture classique)
- Philippe Blanchet, « Frontières historiques et culturelles », dans Zou, Boulégan ! Expressions familières de Marseille et de Provence, Éditions Bonneton, 2000.
- Pierre Bec, Manuel pratique d'occitan moderne, Picard, 1983
- Robert Lafont, L'ortografia occitana. Lo provençau, Montpellier, CEO, 1972
- Hervé Lieutard, « Spécificité morphologique du pluriel languedocien : la notion de cheville », Cahiers de Grammaire,
- « Relations graphie-phonie : les diphtongues et les triphtongues », sur locongrès.org (consulté le )
- Guy Martin et Bernard Moulin, Gramatica provençala, CREO-Provença-IEO, Calade Diffusion (ÉDISUD), pages 20-21
- André et Michel Compan, Histoire de Nice et de son Comté, Éditions Campanile, p. 148
- Charles Arnoux, Le Bréviaire de la langue provençale où sont groupés par ordre d'idées les mots et expressions des divers domaines de la vie. : Avant-propos pour faire connaissance avec le lecteur et lui présenter la douce langue provençale. (lire en ligne)
- « Vèrb'Òc », sur Lo congrès
- Emmanuel Gioan, Conjuguer en… Nissart !, Édition du CRDP de l’académie de Nice (lire en ligne)
- Jean-Baptiste Calvino, Nouveau Dictionnaire Niçois-Français, Nice, Imprimerie des Alpes-Maritimes, (lire en ligne)
- « Progresser en nissart, Leçon 13 : Mais pourquoi écrivez-vous… una plassa de Nissa, una plaça de Nissa ou una plaça de Niça ? », sur Lou Sourgentin : « Ce qui, par contre, était critiquable, c’était la prétention de certains félibres de faire écrire, dans notre langue, niçard, avec un d final : en effet ce -d, parfaitement compatible avec la prononciation du provençal (d final muet), ne l’était pas avec la prononciation niçoise (t final sonore) qui rendait nécessaire le recours à la forme niçart conforme à la spécificité phonétique du niçois et employée par les bons auteurs. »
- Frédéric Mistral, La lenga provençala o lenga d'Oc, IEO de Paris, no 106
- Jean-Pierre Ténnevin, « Les dialectes provençaux », sur ina.fr, , p. 4m15-5m
- Roger Klotz, L'Image des juifs dans le Trésor du Félibrige de Mistral, coll. « Revue des études juives » (no 163), , 295-300 p.
- Philippe Blanchet, De quelques emprunts au judéo-provençal dans la langue et la culture provençales, t. La France latine (no 134), , 123-129 p.
- Association culturelle des Juifs du Pape, « Shuadit-Daberrage »
- Quentin Garnier, « Le vivaro-alpin : progrès d’une définition », Géolinguistique, no 20, (ISSN 0761-9081, DOI 10.4000/geolinguistique.1992, lire en ligne, consulté le )
- Danièle Dossetto, « La langue comme clé mais d’autres clefs que la langue : douze ans de recompositions mistraliennes en Provence‑Alpes‑Côte‑d’Azur », Lengas, no 72 - Aspects idéologiques des débats linguistiques en Provence et ailleurs, (DOI 10.4000/lengas.114, lire en ligne).
- « Déclaration de Briançon : Pour le respect de la diversité de la langue provençale »,
- Hervé Lieutard, « Les systèmes graphiques de l’occitan. Un kaléidoscope des représentations et des changements linguistiques », Lengas. Revue de sociolinguistique, no 86, (ISSN 0153-0313, DOI 10.4000/lengas.4076, lire en ligne, consulté le )
- « Progresser en nissart, leçon 11 : Mais pourquoi écrivez-vous…falhita, bulhì, filha, travalhà, travalh ? Ou du bon usage du lh », sur Lou Sourgentin : « Plus précisément, on trouvera chez ces deux auteurs le gli en position intervocalique. Exemple : la fueglia (la feuille). Micèu, influencé par le français, fait souvent précéder le gli d’un i inutile et écrit vieiglia, paiglia, taiglia, alors que Rancher écrit vieglia, taglia, paglia. En position finale, nos deux auteurs adoptent des solutions différentes : Micèu conserve la notation gli (réduite à gl) et écrit donc travaigl, rouigl (la rouille), recueigl (le recueil). Rancher, lui, est influencé par l’orthographe du français et écrit travail, badail (bâillement), douil, (broc, cruche), ueil (œil), rail (braiment), ferrouil (verrou), tail, buil (ébullition), etc. »
- Jean Sibille, « Écrire l’occitan : essai de présentation et de synthèse. », Écrits divers – Ecrits ouverts, Inalco / Association Universitaire des Langues de France, , p. 17-37 (lire en ligne)
- Joseph Roux, Grammaire limousine, Lemozi, 1893-1895 (lire en ligne) :
« Honnorat, à qui la linguistique est si redevable, intercale pour adoucir le g, un e devant a, o, u : Encouragear, encourager. Cet expédient emprunté à l’orthographe d’oïl n’a pas fait fortune. Nul ne doit s’en plaindre. »
- Pierre Vouland, Du provençal rhodanien parlé à l'écrit mistralien, précis d'analyse structurale et comparée, Aix-en-Provence, Edisud, 2005, 206 pages.
- Pierrette Bérengier, « D’hier à demain : la mise à jour du dictionnaire provençal-français de Frédéric Mistral », dans La communication littéraire et ses outils : écrits publics, écrits privés, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, coll. « Actes des congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques », (ISBN 978-2-7355-0863-1, DOI 10.4000/books.cths.4041, lire en ligne), p. 7–14
- Marius Jouveau, Grammaire provençale : Essai de pédagogie régionale IV, Aix-en-Provence, Porto Aigo, (lire en ligne)
- Joseph Roux, Grammaire limousine, Lemozi, 1893-1895 (lire en ligne) :
« Les anciens lexiques, comme d’ailleurs tous autre ouvrages confondaient le u et le v ; ainsi on écrivait usuellement : sviure, suivre ; uezi, vezi, voisin ect. De là, par exemple mouer pour mover, mouvoir. De là, le mov de Bernat de Ventadour et le mou de Bertrans de Born. L’École d’Avignon tourne la difficulté en recourant à un procédé de son invention : pour mov et pour mou, elle écrirait móu. Le tour est ingénieux, je l’avoue. Seulement, ainsi que nous le dirons en son lieu, la langue limousine (par conséquent le dialecte provençal) n’avait non plus que le latin, aucun accent d’aucune sorte, pas même le tréma (le point sur l’i n’est pas un accent, mais une partie intégrante de ce signe). »
- Damase Arbaud, De l'orthographe provençale : Lettre à M. Anselme Mathieu, Aix-en-Provence, Makaire, (lire en ligne) :
« (À propos de la lettre« r ») D'ailleurs pourquoi cet ostracisme, pourquoi traiter cette lettre avec plus de rigueur que tant d'autres qui ont été conservées par vous bien que l'oreille ne les perçoit pas davantage ? »
- Lo provençau dei vaus e dei còlas : testes occitans de Provença en parlar dau Liberon per ensenhar la lenga. Centre Culturau Cucuronenc, 1982.
- Alain Barthélémy-Vigouroux et Guy Martin, Manuel pratique de provençal contemporain, Edisud,
- Frank R. Hamlin, Peter T. Ricketts et John Hathaway, Introduction à l'étude de l'ancien provençal : textes d'étude, Librairie Droz, , 324 p. (ISSN 0079-7812, lire en ligne)
- Joseph Anglade, Grammaire de l'ancien provençal ou ancienne langue d'Oc, 1921, p. 20 Graphie et Prononciation, Chapitre 1, Première partie Phonétique
- Graphie de l'occitan, Université de Montpellier 3, https://www.univ-montp3.fr/uoh/occitan/une_langue/co/module_L_occitan_une%20langue_11.html
- Guy Martin, Bernard Moulin, dans la partie qui distingue les différences entre écriture mistralienne et classique et montre des exemples de simplifications de l'écriture classique par usage populaire, Dictionnaire provençal-français (Diccionari provençala-francés)
- Guy Martin et Bernard Moulin, Grammaire provençale (Gramatica provençala), CREO-Provença, 2007
- Jean Laffite, Pau en Occitanie ?, lire la page 2 d'une carte de la Société d’études occitanes (S.E.O. - ancêtre de l'IEO) datant de 1932 qui reprend le terme médiéval de "Provensa" avant la normalisation en "Provença" par le CREO-Provença, 2011, http://www.institut-bearnaisgascon.com/wp-content/uploads/2011/11/Pau-en-Occitanie-_.pdf
- Elie Lebre, Guy Martin, Bernard Moulin, Dictionnaire de base français-provençal, CREO-IEO-Provença, 2004, page 10
- Philippe Blanchet, « Contacts et dynamique des identités culturelles : les migrants italiens en Provence dans la première partie du XXe siècle », La France latine, Paris, no 137, , p. 141-166 (lire en ligne, consulté le )
- Philippe Blanchet, « Usages actuels du provençal dans la signalétique urbaine en Provence : motivations, significations et enjeux sociolinguistiques », Revue de l'Université de Moncton, vol. 36, no 1, , p. 255–287 (lire en ligne, consulté le )
- « Vaucluse. Les panneaux de signalisation en provençal pourront finalement rester », sur ouest-france.fr, (consulté le )
- UNESCO, Atlas des langues en péril dans le monde, p. 29. La partie européenne de cet atlas, réalisée par le linguiste finlandais Talpani Salminen, spécialiste du finno-ougrien, individualise les différents dialectes de la langue d'oc. L'UNESCO, dans d'autres publications, et le Summer Institute of Linguistics, dans la norme ISO 639-3, rendent compte parallèlement d'une unité de la langue d'oc dans sa diversité.
- Sur l’espace couvert, voir l’article de Danièle Dossetto. "La langue comme clé mais d’autres clefs que la langue : douze ans de recompositions mistraliennes en Provence‑Alpes‑Côte‑d’Azur". Lengas no 72, 2016. p. 51-82. lire en ligne
- Il s'appuie sur la thèse de Philippe Blanchet, Le provençal, essai de description sociolinguistique différentielle, Peeters, 1992, qui compile un certain nombre de théories sociolinguistiques mettant en avant « la conscience linguistique et les usages effectifs des locuteurs et des institutions », tout en en rejetant d'autres (comme la notion de diglossie)
- (en) James Costa Wilson et Médéric Gasquet-Cyrus, « What is language revitalization really about? Competing language revitalization movements in Provence », dans Mari C. Jones et Sarah Ogilvie, Keeping Languages Alive: Documentation, Pedagogy and Revitalization, Cambridge University Press, (ISBN 978-1-107-02906-4, lire en ligne), p. 212-224
- Ph. Blanchet, op.cit. Stephen Wurms, dans l'Atlas des langues en péril dans le monde, UNESCO, 1996 et sa réédition en ligne, 2009, ne distingue pas le provençal de l'occitan mais de l'ensemble des dialectes d’oc : auvergnat, gascon, languedocien, limousin et vivaro-alpin.
- Sylvie Sagnes. "Unité et (ou) diversité de la (des) langue(s) d’oc : histoire et actualité d’une divergence". Lengas no 71, 2012. Pp. 51-78. Lire en ligne.
- « En préambule à nos doléances, nos postulats :
- Les traditions provençales font partie intégrante de la culture provençale.
- La langue originelle de la Provence est le provençal codifié par Frédéric Mistral.
- Notre région ne se nomme pas PACA mais Provence (ou, pour le respect de ses limites géographiques et historiques, Pays de Provence).
- La prise en compte comme langue de France du provençal, langue codifiée par Frédéric Mistral. Son enseignement doit se faire en graphie mistralienne.[...] ». "Les questions posées aux candidats des élections régionales. Pour une Région Provence au service de sa langue et de sa culture". Site du Collectif Provence. Lire en ligne
- « l’abrogation de la graphie dite « classique » (ou occitane) en Provence ». "7 lettres essentielles pour la reconnaissance du provençal ". Site du Collectif Provence. Lire en ligne
- « La langue d’Oc », sur Felibrige.org
- mention sur le site Prouvènço presso
- texte sur le site de l'IEO Provence
- Rapport Assemblée plénière Conseil régional 24-06-2016.
- Philippe Blanchet, Le parler de Marseille et de Provence, dictionnaire du français régional, Éditions Bonneton, Paris, 2004 (version revue et corrigée du Dictionnaire du français régional de Provence, Paris, Bonneton, 1991)
- Philippe Blanchet, « Frontières historiques et culturelles », dans Zou, Boulégan ! Expressions familières de Marseille et de Provence], Éditions Bonneton, 2000.
- Frédéric Mistral, Lou Tresor dou Felibrige, voir le mot lengo d'o, https://www.lexilogos.com/provencal/felibrige.php?q=lengo+d%27oc
- Pierre Bec, La langue occitane p. 63-64
- Salvat Joseph. "Provençal ou occitan ?". In: Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, Tome 66, No 27, 1954. Hommage à la mémoire d’Alfred Jeanroy. p. 229-241. Consulté le 20 août 2015.
- Lou Felibre de Bello Visto (pseudonyme de F. Mistral), "La lengo prouvençalo o lengo d'O", Armana Prouvençau, 1856. Réédition Frederic Mistral, "La lenga provençala o lenga d'Òc", Documents per l'estudi de la lenga occitana no 106, Paris: IEO París, 2016.
- Dictionnaire d’Honnorat en ligne
- Jules Ronjat, Mâcon, 1913 Essai de syntaxe des parlers provençaux modernes en ligne
- Jules Ronjat, Montpellier, Société des Langues Romanes, 1930-41. Dans sa grammaire J. Ronjat définit aussi, au tome IV, le provençal comme dialecte (A, dans sa nomenclature).
- Constanze WETH. « L'occitan / provençal ». Manuel des langues romanes, Edited by Klump, Andre / Kramer, Johannes / Willems, Aline. DE GRUYTER. 2014. Pages: 491–509. ISBN (lire en ligne): 9783110302585
- «Qu’est-ce que le Midi ? Une vaste région qui se caractérise d’abord par l’existence de ce qu’on peut appeler les pays d’oc, c’est-à-dire de langue provençale ou occitane.» Emmanuel Le Roy Ladurie. "Portrait historique de la France du Sud". L’’Histoire, no 255 (juin 2001). p. 34. (lire en ligne)
- Frédéric Mistral, Lou Tresor dou Felibrige, voir le mot Oucitan, Oucitanio, https://www.lexilogos.com/provencal/felibrige.php?q=oucitan
Bibliographie
![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
- Philippe Blanchet, Le provençal : essai de description sociolinguistique et différentielle, Institut de Linguistique de Louvain, Louvain, Peeters, (lire en ligne).

- Bernard Giély, Grammaire du verbe provençal, Prouvènço d'aro, .

- Simon-Jude Honnorat, Dictionnaire Provençal-Français ou dictionnaire de la langue d’Oc ancienne et moderne, vol. 1 (A-D), Digne, Repos éditeur, 1846-1847 (lire en ligne).

- Simon-Jude Honnorat, Dictionnaire Provençal-Français ou dictionnaire de la langue d’Oc ancienne et moderne, vol. 3 (P-Z), Digne, Repos éditeur, 1846-1847 (lire en ligne).

- Jules Ronjat, Grammaire istorique (sic)[alpha 1] des parlers provençaux modernes, Montpellier, Société des langues romanes, 1930-1941 (lire en ligne).

Ouvrages généraux sur le provençal
- Jean-Philippe Dalbera, Les parlers des Alpes Maritimes: étude comparative, essai de reconstruction [thèse], Toulouse: Université de Toulouse 2, 1984, édité en 1994, Londres, Association Internationale d’Études Occitanes.
- Jules (Jùli) Ronjat, L’ourtougràfi prouvençalo, Avignon: Vivo Prouvènço!, 1908.
- Philippe Blanchet, Découvrir le provençal, un "cas d'école" sociolinguistique, cours en ligne de l'Université Ouverte des Humanités, 2020.
- Philippe Blanchet, Langues, cultures et identités régionales en Provence. La Métaphore de l’aïoli, Paris, L'Harmattan, 2002.
- Pierre Vouland, Du provençal rhodanien parlé à l'écrit mistralien, précis d'analyse structurale et comparée, Aix-en-Provence, Edisud, 2005, 206 pages.
- Robèrt Lafont, L’ortografia occitana, lo provençau, Montpellier: Universitat de Montpelhièr III-Centre d’Estudis Occitans, 1972.
- Robert Lafont, Phonétique et graphie du provençal: essai d’adaptation de la réforme linguistique occitane aux parlers de Provence, Toulouse: Institut d’Études Occitanes, 1951 [rééd. 1960]
Ouvrages lexicographiques sur le provençal
- Élie Lèbre, Guy Martin, Bernard Moulin, Dictionnaire de base français-provençal / Diccionari de basa francés-provençau, Aix-en-Provence: CREO Provença / Edisud, 2004 (1re éd. 1992)
- Jòrgi Fettuciari, Guiu Martin, Jaume Pietri, Dictionnaire provençal-français / Diccionari provençau-francés, Aix-en-Provence: Edisud / L’Escomessa / CREO Provença, 2003.
- Jules Coupier, Dictionnaire français-provençal, Aix, Edisud, 1512 p., 1995. Grand Prix Littéraire de Provence 1996.
- Maritime
- Philippe Blanchet, Dictionnaire fondamental français-provençal. (Variété côtière et intérieure), Paris, éditions Gisserot-éducation, 2002. Présentation et aperçu partiel
- Niçois
- Georges Catellana, Dictionnaire français-niçois, 1952 [rééd. Éditions Serre, Nice, 2001]
- Georges Castellana, Dictionnaire niçois-français, 1947 [rééd. Éditions Serre, Nice, 2001]
- Jean-Baptiste Calvino, Nouveau dictionnaire niçois-français, Nice: Imprimerie des Alpes Maritimes, 1905 [rééd. 1993 sous le titre: Dictionnaire niçois-français, français-niçois, Nîmes: Lacour]
- Rhodanien
- Jules Coupier, (collab. Philippe Blanchet) Dictionnaire français-provençal / Diciounàri francés-prouvençau, Aix en Provence: Association Dictionnaire Français-Provençal / Edisud, 1995.
Grammaires / manuels
- Alain Barthélémy-Vigouroux & Guy Martin, Manuel pratique de provençal contemporain, Aix-en-Provence, Édisud, 2000
- André Compan, Glossaire raisonné de la langue niçoise, Éditions Tiranty, Nice, 1967, [rééd. Éditions Serre, Nice, 1982]
- André Compan, Grammaire niçoise, Éditions Tiranty, Nice, 1965, [rééd. Éditions Serre, Nice, 1981]
- Bruno Durand,Grammaire provençale, Aix-en-Provence, 1923, [6e édition, Marseille, 1983]
- Guy Martin et Bernard Moulin, Grammaire provençale et atlas linguistique, Aix-en-Provence, Comitat Sestian d'Estudis Occitans / C.R.E.O Provença / Édisud, , 2e éd. (1re éd. 1998), 193 p. (ISBN 978-2-9530712-1-4)
- Philippe Blanchet & Médéric Gasquet-Cyrus, Le Marseillais de poche, Chennevières/Marne, Assimil, 2004
- Philippe Blanchet, Parle-moi provençal, méthode d’auto-apprentissage du provençal, Chennevières, Assimil, 2010, 230 p. + 2 CD.
- Reinat Toscano, Gramàtica niçarda, sl.: Princi Néguer, 1998
- Savinian, Grammaire provençale, Collection Rediviva, Lacour S.A., Nîmes, 1991
- Virgine Bigonnet, Simon Calamel et Philippe Blanchet, Le Provençal de poche, Chennevières/Marne, Assimil, 2005
Ouvrages sur le provençal et sa place dans les langues romanes
- Charles Camproux, Les Langues romanes, Paris, Presses Universitaires de France, 1974, 126 pages.
- Jean Lafitte et Guilhem Pépin : La langue d'Oc ou leS langueS d'Oc ? Editions PyréMonde, 2009.
- Pierre Bec, La langue occitane, coll. « Que sais-je ? », no 1059, Paris, Presses Universitaires de France, 1995 (1re édition 1963)
Notes
- Ronjat écrivait sans « h » initial: « les ommes », « l'istoire », « istorique », etc.
Références
Sources bibliographiques :
- Frédéric Mistral, Lou Tresor dóu Felibrige ou dictionnaire provençal-français embrassant les divers dialectes de la langue d'oc moderne, vol. 1 (A-F), Aix-en-Provence, Remondet-Aubin, 1878-1886 (lire en ligne).

- Mistral 1878-1886, p. 10797
- Mistral 1878-1886, p. 10834
- Mistral 1878-1886, p. 11190
- Mistral 1878-1886, p. 10076
- Frédéric Mistral, Lou Tresor dóu Felibrige ou dictionnaire provençal-français embrassant les divers dialectes de la langue d'oc moderne, vol. 2 (G-Z), Aix-en-Provence, Remondet-Aubin, 1878-1886 (lire en ligne).

- Mistral 1878-1886, p. 21145
- Mistral 1878-1886, p. 20422
- Mistral 1878-1886, p. 20226
- Mistral 1878-1886, p. 20173
- Mistral 1878-1886, p. 20209
- Mistral 1878-1886, p. 21072
- Mistral 1878-1886, p. 20879
- Mistral 1878-1886, p. 20878
- Mistral 1878-1886, p. 220607
- Mistral 1878-1886, p. 20119
- Mistral 1878-1886, p. 20407
- Mistral 1878-1886, p. 20431
- Simon-Jude Honnorat, Dictionnaire Provençal-Français ou dictionnaire de la langue d’Oc ancienne et moderne, vol. 2 (E-O), Digne, Repos éditeur, 1846-1847 (lire en ligne).

- Honnorat 1846-1847, p. 584
- Antoine Léandre Sardou et Jean-Baptiste Calvino, Grammaire de l'idiome niçois, Nice, Librairie Visconti, (lire en ligne).

- Sardou-Calvino 1882, p. 28
- Sardou-Calvino 1882, p. 27
Sources webographiques :
Philippe Blanchet, Fiche de présentation du provençal pour le site du CNRS
- Josiane Ubaud, « Violences de langue, violences faites à la langue...ou les pitoyables batailles de normes et de graphies... », (consulté le ).

- Ubaud 2013, p. 3
- Ubaud 2013, p. 2
- Ubaud 2013, p. 5
- Ubaud 2013, p. 19
Autres sources
Articles connexes
- Occitanie
- linguistique
- liste de langues
- langues par famille
- liste de langues
Liens externes
- Notices d'autorité :
- Ciel d'oc : le Centre International de l’Écrit en Langue d’Oc (Ciel d'oc) a numérisé en collaboration avec l'Université de Provence de nombreuses œuvres littéraires et périodiques en provençal.
- Portail des langues
- Portail des minorités
- Portail de l’Occitanie
- Portail de la Provence
- Portail de Nice
На других языках
[en] Provençal dialect
Provençal (/ˌprɒvɒ̃ˈsɑːl/, also UK: /-sæl/,[4] US: /ˌproʊ-, -vən-/; French: provençal [pʁɔvɑ̃sal], locally [pχɔvãⁿˈsalə]; Occitan: provençau or prouvençau [pʀuvenˈsaw]) is a Romance language, either considered as a variety of Occitan or a separate language, spoken by people in Provence and parts of Drôme. Historically, the term Provençal has been used to refer to the whole of the Occitan language, but today it is considered more technically appropriate to refer only to the variety of Occitan spoken in Provence.[5][6] However it can still be found being used to refer to Occitan as a whole, e.g. Merriam-Webster states that it can be used to refer to general Occitan, though this is going out of use.[7]- [fr] Provençal
[it] Dialetto provenzale
Il provenzale[1] (in provenzale [pʀuveⁿsˈaw], ortografato prouvençau nella grafia mistraliana e provençau nella grafia classica) è un dialetto dell'occitano o lingua d'oc[2][3][4] parlato essenzialmente in Provenza e in una parte del Gard. Vi è anche un movimento regionale, per il quale[5] il provenzale è "una lingua a pieno titolo, vicino ma distinto dall'occitano della Francia" sud-occidentale.[6][ru] Провансальский диалект
Прованса́льский диале́кт (провансальское наречие; фр. Provençal, окс. Prouvençau [pʀuveⁿsˈaw] в мистральской орфографии или Provençau в классической орфографии) — одно из наречий окситанского языка[к 1][к 2] распространён прежде всего в Провансе и в восточной части департамента Гар[1]. Количество носителей — более 100 000 человек (1999)[2].Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.
WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии




